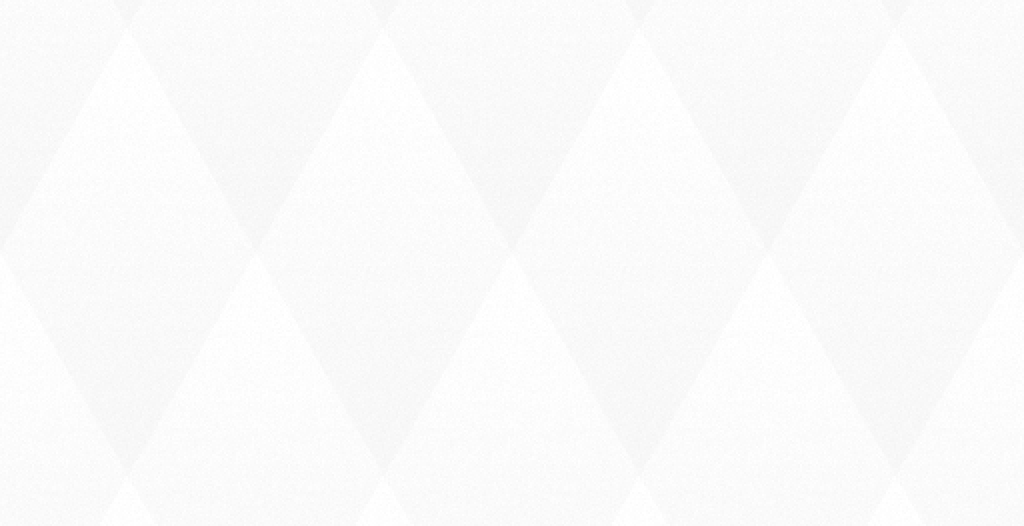For optimal readability, we highly recommend downloading the document PDF, which you can do below.
Document Information:
- Year: 2009
- Country: Transnational
- Language: French
- Document Type: Publication
- Topic: Defending Civil Society,Regional/Global Overviews
This document has been provided by the
International Center for Not-for-Profit Law (ICNL).
ICNL is the leading source for information on th e legal environment for civil society and public
participation. Since 1992, ICNL has served as a resource to civil society leaders, government
officials, and the donor community in over 90 countries.
Visit ICNL’s Online Library at
https://www.icnl.org/knowledge/library/index.php
for further resources and research from countries all over the world.
Disclaimers Content. The information provided herein is for general informational and educational purposes only. It is not intended and should not be
construed to constitute legal advice. The information contai ned herein may not be applicable in all situations and may not, after the date of
its presentation, even reflect the most current authority. Noth ing contained herein should be relied or acted upon without the benefit of legal
advice based upon the particular facts and circumstances pres ented, and nothing herein should be construed otherwise.
Translations. Translations by ICNL of any materials into other languages are intended solely as a convenience. Translation accuracy is not
guaranteed nor implied. If any questions arise related to the accuracy of a translation, please refer to the original language official version of
the document. Any discrepancies or differences created in the tr anslation are not binding and have no legal effect for compliance or
enforcement purposes.
Warranty and Limitation of Liability. Although ICNL uses reasonable efforts to include ac curate and up-to-date information herein, ICNL
makes no warranties or representations of any kind as to its a ccuracy, currency or completeness. You agree that access to and u se of this
document and the content thereof is at your own risk. ICNL discl aims all warranties of any kind, express or implied. Neither ICNL nor any
party involved in creating, producing or delivering this document shall be liable for any damages whatsoever arising out of access to, use of
or inability to use this document, or any e rrors or omissions in the content thereof.
Août 2009
LL EE RR OO LL EE DD EE LL AA RR EE FF OO RR MM EE JJ UU RR IIDD IIQQ UU EE
EE NN SS OO UU TT IIEE NN AA LL AA SS OO CC IIEE TT EE CC IIVV IILL EE ::
D OCUMENT D ’ORIENTATION
Centre international de d roit des associations à but
non lucratif
et
Programme des Nations Unies p our le Développement
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 2
Copyright © PNUD 2009
Tous droits réservés
Publié aux Etats -Unis d’Amérique
Remerciements
Ce document de référence est un effort conjoint du Centre i nternational de droit des
associations à but non lucratif (ICNL) et du Programme des Nations Unies pour le
Développement (PNUD). Il a été commandé par le PNUD et élaboré par David Moore, Vice –
président des Affaires juridiques de l’ ICNL, avec le soutien de Douglas Rutzen, Président et
PDG de l’ICNL.
Le Groupe de lutte contre la Pauvreté du Bureau des Politiques de Développement du PNUD a
bien voulu apporter son so utien à ce document . Sa p roduction au sein du PNUD est le fruit
d’une collaboration entre le Centre régional de Bratislava, le Centre d’Oslo pour la
Gouvernance – Bureau des Politiques de Développement et la Division de la Société civile –
Bureau des Parte nariats .
Nous remercions les collègues suivants du PNUD pour leur contribution au document et leurs
critiques :
Geoffrey D. Prewitt, Conseiller principal en Gouvernance du PAPP ( ancien Conseiller pour la
Réduction de la Pauvreté et la Société civile au Ce ntre régional de Bratislava), qui a commandé
le document à l’ ICNL, a fourni une rétroaction importante et a coordonné les contributions aux
premiers avant -projets ; Sarah Lister, Conseillère en Gouvernance et Société civile du Centre
d’Oslo pour la Go uvern ance, Bharati Sadasivam, Conseiller pour les Politiques et Beniam
Gebrezghi, Spécialiste des Programme s, Division de la Société civile – Bureau des Partenariats
pour leur travail dans la mise au point de l’avant -projet final .
Nous tenons aussi à remercier les collègues suivants du PNUD qui ont passé en revue les
différents avant -projets et ont fourni une rétroaction importante et précieuse : Masood Amer
(Afghanistan), Luca Bruccheri (Zambie), Nana Busia (Sierra Leone), Beatriz Fernandez ( Division
de la Soc iété civile – Bureau des Partenariats ), Nessie Golakai (Lib eria ), Max Ooft (Surinam ),
Olivera Puric (Serbie), Paavani Reddy ( Centre d’Oslo pour la Gouvernance ), Fekadu Terefe
(Ethiopi e) et Magda Verdickt ( Maurice ).
En outre , le PNUD et l’ ICNL sont reconna issants à leurs partenaires – gouvernementaux et de
la société civile – qui ont réalisé le travail décrit dans ce document d’orientation et qui sont
aussi impliqués dans la promotion du cadre juridique pour la société civile dans le monde .
Clause de non r esponsabilité
Les opinions exprimées dans cette publication sont celles de l’auteur (des auteurs) et ne
représentent pas nécessairement celles des Nations Unies ou du PNUD .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 3
Sommaire
PREFACE ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………………………….. ….. 4
AVANT -PROPOS ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………… 5
I. INTRODUCTION ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………….. 6
Définitions ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………. 7
Contenu et Structure ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………. 8
II. APERÇU DU CADRE JURID IQUE POUR LA SOCIETE CIVILE ………………………….. ………………………….. …… 9
A. Droit international et société civile ………………………….. ………………………….. …………….. 9
B. Cadre juridique et réglementaire national affectant les OSC ………………………….. ……….. 17
C. Identifier les éléments du Droit des associations de la Société civile ………………………… 20
D. Importance du cadre juridique et régle mentaire pour la société civile ……………………… 26
III. VUE D ’ENSEMBLE DE L ’ENVIRONNEMENT JURID IQUE DANS CERTAINS P AYS ………………………….. ……… 30
A. Afghanistan ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………… 30
B. Libéria ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………… 32
C. Maurice ………………………….. ………………………….. ………………………….. …………………….. 35
D.Serbie ………………………….. ………………………….. ………………………….. ……………………….. 37
IV. ROLE DES ACTEURS INTE RNATIONAUX ………………………….. ………………………….. ………………….. 40
A. Critères de seuil ………………………….. ………………………….. ………………………….. ………… 40
B. Exécution de la réforme juri dique ………………………….. ………………………….. …………….. 42
C. Poursuite de la réforme juridique ………………………….. ………………………….. ……………… 50
D. Au -delà de la réforme juridique ………………………….. ………………………….. ……………….. 53
V. LISTE DE CONT ROLE POUR LA CONCEPT ION DE PROGRAMMES ………………………….. ……………………… 57
ANNEXE A : FOIRE AUX QUESTIONS (FAQ) ………………………….. ………………………….. …………………. 59
ANNEXE B : RESSOURCES SUR LA SOCIETE CIVILE ………………………….. ………………………….. …………… 62
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 4
Préface
Cette année marque l’anniversaire de deux réalisations scientifiques. Il y a quat re cent s ans, Galilée a fait une
adaptation subtile mais profonde du microscope optique inventé quelques années auparavant. Plutôt que de
regarder en bas, Galilée a tourné sa longue -vue vers le ciel de nuit. Parmi d’autres observations, Galilée a
découver t les « astres de Médicis » tournant autour de Jupiter. Aujourd’hui on les appelle les lunes de Jupiter
et elles ont démontré que tous les corps célestes ne tournent pas autour de la terre. Ses observatio ns ont
suggéré que nous ne sommes pas le centre de l ’univers en dépit des protestations contraires de la part de ses
contemporains. Aussi bien au sens littéral que figuré, Galilée a révolutionné la science en élargiss ant sa
perspective et en regardant vers l’extérieur.
Il en va de même pour une autre lumi ère scientifique que nous célébrons cette année. En 1859, Charles Darwin
a publié l’Origine des Espèces . Tout comme Galilée, les notions de Darwin n’auraient pas été possibles s’il avait
étudié ce qui est proche plutôt que ce qui est loin. En effet, c’est en voyageant à bord du HMS Beagle que
Darwin a rencontré tous types d’animaux, dont plusieurs étaient inconnus en Angleterre. Le fait d’étudier des
environnements différents – plus spécifiquement l’identification de similitudes et de différences – a décle nché
la créativité et l’innovation intellectuelle.
C’est dans un esprit similaire que nous présentons ce document d ’orientation . Nous ne présentons pas de
« solutions » car nous avons travaillé dans plus de 100 pays et nous reconnaissons que le cadre jurid ique pour
la société civile doit être adapté à l’environnement local. En revanche, nous avons travaillé avec n os
partenaires du PNUD pour partager des perspectives comparatives en vue de faciliter la pensée créatr ice.
Le besoin d’innovation est évident lor sque nous examinons la confluence de défis contemporains, y compris
la pauvreté, le VIH -SIDA, les changements climatiques et d’autres obstacles au développement humain. De
plus, la crise financière mondiale a contribué à un réétalonnage de la gouvernance. Cela apparaît le plus
clairement dans les relations entre les gouvernements et le milieu des affaires, au fur et à mesure que les
limites sectorielles s’estompent et que les gouvernements renforcent leur mainmise afin de guider le s forces
du marché.
Ce réétalonnage s’étend aussi à la société civile. Au cours de l’année dernière seulement, plus de soi xante
pays ont mené des initiatives juridiques tendant à redéfinir les droits et responsabilités des organ isations de la
société civile. Certaines initiati ves permettent des réponses de l’ensemble de la société aux défis
contemporains. D’autres limitent l’espace civi l et entravent la gouvernance participative. En tout état de
cause , le cadre juridique pour la société civile est une manifestation primordiale de la théorie de gouvernance
d’un pays et joue un rôle clé dans la capacité des nations à faire avancer le développement humain.
Nous espérons que ce document d ’orientation sera une ressource utile pour les gouvernements, la société
civile et les institut ions multilatérales cherchant à promouvoir un environnement favorable à la société civile.
Nous remercions le PNUD pour ses conseils et son précieux soutien et nous exprimons notre gratitude à nos
partenaires à travers le monde qui nous ont tellement appr is.
Doug Rutzen David Moore
Président Vice -président, Affaires juridiques
ICNL ICNL
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 5
Avant -propos
La réussite de la gouvernance démocratique dépend de l’existence tant d’un Etat solide que d’une soc iété
civile saine et active. Des taux élevés de participation citoyenne sont un élément essentiel de la gouverna nce
participative qui de nos jours porte de plus en plus sur la création d’institutions démocratiques in tégratrices et
à l’écoute et l’augmentation des poss ibilités pour la participation citoyenne .
Un facteur crucial au bon fonctionnement des organisations de la société civile au sein d’un pays c’est le cadre
juridique et réglementaire permettant et régissant leur établissement, espace et portée pour foncti onner dans
la vie publique. Une société civile saine profite de la primauté du droit et de la jouissance de dro its civils et
politiques, y compris la liberté d’expression, le droit d’association et la participation aux affair es publiques.
Des cadres réglem entaires adéquats sont étroitement liés au droit d’une société au développement et à la
définition de modèles de développement à travers des processus démocratiques et intégrateurs.
Le PNUD peut jouer un rôle stratégique en servant d’intermédiaire dans le s relations entre l’Etat et les
citoyens, notamment dans les démocraties fragiles ou dans les pays consolidant des gains démocratiqu es, en
plaidant en faveur d’un soutien et d’un environnement favorable où la société civile puisse fonction ner et
contribuer au développement.
Plusieurs gouvernements recherchent de plus en plus les conseils et le soutien du PNUD en vue de la
formulation d’un cadre juridique et réglementaire pour la participation civique dans les affaires pu bliques. Un
inventaire mondial en 20 08 de l’engagement des bureaux pays avec la société civile a démontré que 60 pour
cent des bureaux pays en Afrique et en Europe – CEI ont signalé une forte implication dans le soutien des
cadres juridiques. Toutefois, l’enquête a aussi démontré que des eff orts supplémentaires s’avèrent
nécessaires dans trois régions : presque la moitié des bureaux pays des régions d’Asie -Pacifique, des Etats
arabes et d’Amérique latine et de la Caraïbe ont signalé peu d’engagement voire aucun dans ce domaine.
Ce document d’orientation a été élaboré par le Centre international de droit des associations à but non
lucratif, qui se spécialise dans ce domaine et qui travaille avec les gouvernements et les sociétés civiles dans
plusieurs pays en développement pour aider à élabore r des lois progressistes. Grâce à ses définitions et
explications des différents types de cadres réglementaires existants, ses exemples d’études de cas et de
leçons apprises des pays et ses conseils concernant la manière de soutenir les gouvernements et l a société
civile, ce document d’orientation est un guide complet et détaillé à l’intention des collègues dans les bureaux
pays et centres régionaux traitant cette question importante et souvent délicate.
Bjoern Foerde Thierno Kane
Direct eur, Centre d’Oslo pour la Gouvernance Directeur, Division de la société civile
Bureau des Politiques de Développement Bureau des Partenariats
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 6
I. Introduction
L’attention portée à la société civile et au large éventail d’organisations qui remplissent l’espace entre l’Etat et
le marché a considérablement a ugmenté ces 20 dernières années. Nous assistons à une « révolution
associative mondiale » ou bien une « recrudescence massive des activités privées et bénévoles organisées
dans pratiqu ement toutes les régions du monde. ».1 Les organisations de la société civile [OSC] jouent un rôle
de plus en plus actif dans les domaines social, économique et politique. Les organisations multilat érales, y
compris les Nations Unies et la Banque mondiale, ont reconnu le rôle important de la société civile et ont
établi des mécanismes d’engagement et de dialogue avec les OSC. 2 Une société civile forte est une fin
importante en soi, de même qu’un moyen crucial vers la réalisation d’objectifs spécifiques, tel s que les
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD ).
Le cadre juridique d’un Etat est un des nombreux facteurs influant sur la mesure dans laquelle
l’environnement global est favorable à la société civile et à ses organisations. Un cadre juridiqu e favorable ne
garantit aucunement une société civile dynamique et un cadre juridique défavorable ou restrictif ne constitue
pas nécessairement un obstacle insurmontable à la participation de la société civile dans les affair es publiques.
Néanmoins, le cad re juridique joue un rôle clé et un cadre juridique global favorable peut être considéré une
condition nécessaire, mais non suffisante, du développement d’une société civile forte et durable.
Les lois et politiques ayant une incidence sur la société civi le sont très dynamiques et instables et souvent
sujettes au changement. Plusieurs pays ont révisé et continuent de mettre au point le cadre juridiqu e et
réglementaire régissant les OSC. Une telle révision est tantôt favorable à la société civile tantôt con traignante.
Des contextes divers nécessitent une gamme de réponses différentes et les acteurs internationaux doi vent
toujours envisager une large gamme d’initiatives pour soutenir la société civile.
Dans tous les contextes, les acteurs internationaux doiv ent identifier soigneusement les possibil ités de
réforme et le cas échéant :
1. Améliorer le cadre juridique régissant la société civile ;
2. Améliorer le processus d ’application de la loi régissant la société civile ; ou
3. Dans les cas où l’espace consacré à la s ociété civile est restrictif mais que la réforme juridique ne soit
pas viable à l’heure actuelle, les stratégies les plus appropriées pour protéger la société civile, renforcer
ses compétences pour survi vre et répondre le cas échéant et établir la base d’u ne réforme future.
Ce document a pour objectif de donner (1) un aperçu préliminaire de l’environnement juridique pour la société
civile et (2) une orientation générale à la réforme de la société civile pour les acteurs internationaux qui
donnent des cons eils sur ou qui sont impliqués dans la conception ou le développ ement de programmes
destinés à promouvoir un environnement plus favorable à la société civile.
1 Lester M. Salamon, S. Wojciech Sokolowski et Regina List, Global Civil Society: An Overview , Centre d’Etudes sur la Société civile,
Université Johns Hopkins, © 2003, Leste r M. Salamon. 2 Les principaux documents orientant l’engagement du PNUD avec la société civile sont disponibles ici : Pour obtenir des informations
sur l’engagement global de l’ONU avec la s ociété civile, voir par exemple , Service de liaison des Nations Unies avec les organisations
non -gouvernementales : Points de contact pour les ONG ; Renforcer le Partenariat entre l’ONU et les ONG ; Section ONG du DAES .
Pour la Banque mondiale, voir Dialogue de la Banque mondiale avec la société civile .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 7
Définitions
Il est important de définir ce qu’on entend par « société civile » et OSC. Des liv res entiers ont été écrits sur la
signification de la « société civile »3 et la définition de ce concept s’est avé rée une tâche complexe et parfois
un processus controversé. Le secteur de la « société civile » a été libellé le « troisième » secteur, le secteur
« bénévole », le secteur « non lucratif », le secteur « caritatif » ou « indépendant » et « l’économie sociale ». Les
organisations constituant la société civile prennent plusieurs formes, y compris des associations, f ondations,
sociétés à but non lucratif, sociétés privées d’utilité publique, organisations de développement, organisations
communautaires, assemblées religieuses et organisations confessionnelles, hôpitaux, universités, gro upes de
secours mutuel, clubs sportifs, groupes de plaidoyer, organisations artistiques et culturelles, associations
caritatives, unions et associations professionnelles, organisations d’aide humanitaire, prestataires de services
non lucratifs et fondations caritatives. Pris ensemble, ils sont généralement appelés or ganisations non –
gouvernementales (ONG), organisations à but non lucratif (NPO), ou organisations de la société civil e (OSC).
Aux fins de ce document d ’orientation , le PNUD définit les organisations de la société civile dans le cadre de sa
Politique d’ enga gement avec les OSC (2001) 4: « Les OSC sont des acteurs non étatiques qui ne visent ni à
générer des profits ni à rechercher un pouvoir de direction. » Cette définition tend à englober le large
éventail de formes organisationnelles énumérées dans le paragr aphe précédent. Dans la définition du PNUD,
les partis politiques ne sont pas inclus comme appartenant à la société civile, bien qu’ils soient c lairement des
acteurs importants dans les contextes de développement et que le PNUD s’engage auprès d’eux dans une
variété de contextes et de différentes manières. 5 Par ailleurs, certaines questions concernant la liberté
d’association influent aussi sur les partis politiques donc ils sont utilisés dans ce document comme des
exemples le cas échéant. 6 Ce document ut ilisera généralement le s terme s « société civile » ou « OSC » mais
peut faire référence à d’autres termes (« ONG » ou « NPO »), lorsque ces derniers sont utilisés par d’autres
sources.
Aux fins de ce document d ’orientation le terme « acteurs internatio naux » comprend l’ONU, notamment le
PNUD et d’autres organisations multilatérales telles que la Banque mondiale, l’OSCE et la Communauté
européenne, ainsi que les organisations gouvernementales bilatérales et les ONG internationales. Nou s
reconnaissons l’é chantillon large et divers de missions, mandats, points d’entrée et outils de soutien et
d’intervention disponibles. Ce document n’est pas destiné exclusivement au PNUD et ne prétend pas do nner
des conseils sur la stratégie appropriée pour un pays donné ni fournir des orientations sur la façon de mettre
en œuvre une stratégie donnée. En revanche, le document cherche à soulever des questions d’intérêt
commun ayant trait à la réforme juridique de la société civile. La stratégie la plus efficace et la mise en œuvre
d’une stratégie donnée ne peuvent être identifiées que par ceux qui travaillent dans le contexte spé cifique
d’un pays.
3 De nombreuses études ont tenté de définir la société civile et de catégoriser les organisations de l a société civile. Pour des exemples
voir le Projet de Manuel sur les Organisations sans but lucratif de l’ONU , Centre Johns Hopkins pour les Etudes sur la Société civile ; Ecole
d’Ec onomie de Londres, Centre pour la Société civile ; Indice CIVICUS de la Société civile . 4 Voir PNUD (2001) Le PNUD et les Organisations de la Société civile : Politique d’Engagement 5 Voir PNUD (2005) Guide du Travail avec les Partis politiques . 6 Parfois les Organisations de populations autochtones (IPO) ne se qualifient pas d’ONG ou d’OSC car d ans certains contextes el les ne
veulent pas être prises en compte dans la législation et les structur es gouvernementales, qui, à leur avis, mineraient leur droit à
l’autodétermination. Toutefois, ce document ne traite pas les questions spécifiques liées aux IPO, m ême s’il conviendra de pr endre en
compte leurs besoins spécifiques dans les initiatives de ré forme juridique.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 8
Contenu et Structure
La Section II comprend une vue d’ensemble du cadre juridique pour la société civile, en décrivant les base s de
la société civile dans le droit international, les caractéristiques communes des cadres juridiques n ationaux
régissant la société civile, ainsi que l’importance fondamentale du droit pour la société civile. La Section III
présente quatre (4) rapports sur des pays qui passent en revue les défis de la réforme juridique dans chacun
d’entre eux , ainsi que les stratégies de réforme juridique adoptées dans le cadre de la réforme ; ces études de
cas exposent certains éléments clés d’une réforme juridique réus sie. 7 La Section IV vise à donner aux acteurs
internationaux des orientations générales pour soutenir un environnement juridique favorable à la so ciété
civile. Enfin, le document se termine à la Section V par une liste de contrôle destinée aux acteurs de la
réforme. Les réponses à la Foire aux Questions se trouvent en a nnexe .
7 Nous reconnaissons que ces études de cas ne sont que des exemples illustrant les défis liés à la réf orme et les stratégies de réforme.
Les leçons apprises dans la Section IV ne proviennent pas uniquement des études de cas, mais aussi d e l’expérience de l’ICNL dans plus
de 100 pays et de la recherche menée sur la législation de plus de 150 pays.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 9
II. Aperçu du cadre juridique pour la société civile
A. Droit international et société civile
Le cadre juridique international pour la société civile – c’est -à-dire pour la vie as sociative telle qu’elle est
exprimée à travers le large échantillon d’organisations de la société civile – est fondé sur le code de droit
international qui protège les libertés fondamentales d’association, de rassemblement pacifique et
d’expression, ainsi que la liberté de pensée, de conscience et de religion et le droit de prendre part à la
conduite des affaires publiques. 8
Parmi les instruments des droits de l’homme de l’ONU qui défendent ces libertés fondamentales on peu t citer
les suivants :
Déclarati on universelle des Droits de l’homme (DUDH) (1948) : en vertu de l’Article 20 « toute
personne a droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques. »
Pacte international relatif aux droits civils et politiques et Premier Protocole facultatif (PIDC P) (1976) :
en vertu de l’Article 22 « toute personne a le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le
droit de constituer des syndicats et d’y adhérer pour la protection de ses intérêts. »
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (1969) : l’Article 5 déclare
que « conformément aux obligations fondamentales énoncées à l’article 2 de la présente Convention,
les Etats parties s’engagent à interdire et à éliminer la discrimination raciale sous toutes ses for mes et
à garantir le droit de chacun à l’égalité devant la loi sans distinction de race, de couleur ou d’or igine
nationale ou ethnique, notamment dans la jouissance des droits suivants : … droit à la liberté de
réunion et d’association pacifiques. »
Conventio n sur l’Elimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1989) :
l’Article 7 affirme que « les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publi que du pays et, en particulier, leur
assurent, dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit …(c) de participer aux organisations
et associations non gouvernementales s’occupant de la vie publique et politique du pays . »
Convention sur les Droit s de l’Enfant (1990) : l’Article 15 maintient que « les Etats parties reconnaissent
les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique . »
Déclaration de l’ONU sur le Droit et la Responsabilité des individus, groupes et organes de la société
civile de promouvoir et protéger les droits de l’homme et les libertés fondamentales universellement
reconnus (Déclaration des Défenseurs de l’ONU) (1999).
8 Ses origines dans la pensée politique renvoient aux concepts de souveraineté nationale, à travers le squels les individus acco rdent le
pouvoir au souverain mais le pouvoir et l’autorité résident dans le peuple.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 10
Déclaration des Défenseurs de l’ONU , Article 5 :
Afin de promouvoir et protéger l es droits de l’homme et les libertés fondamentales, chacun a le
droit, individuellement ou en association avec d’autres, aux niveaux national et international :
a. De se réunir et de se rassembler pacifiquement ;
b. De former des organisations, associations ou groupes non gouvernementaux, de s’y affilier et
d’y participer ;
c. De communiquer avec des organisations non gouvernementales ou intergouvernementales.
L’Etat a l’obligation de promouvoir le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette
obligation comprend aussi bien une responsabilité « négative » – à savoir, la non ingérence dans les droits et
libertés – que positive – c.-à-d. assurer que le cadre juridique est assez favorable et que les mécanismes
institutionnels nécessaires sont en place pour « garantir à tous les individus » les droits et libertés reconnus. 9
Cela signifie que les Etats ont une certaine obligation de protéger ces droits au titre des tierces parties.
L’Article 2 du PIDCP décrit ex plicitement cette obligation de l’Etat. 10
L’ingérence de l’Etat dans les libertés fondamentales doit avoir une base juridique. D’abord, certa ins droits
sont susceptibles de dérogation dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de l a
nation. 11 Ensuite, le PIDCP établit les paramètres des restrictions du droit à la liberté d’association dans
l’Article 22(2). 12
9 Voir la Charte de l’ONU, Articles 55 -56 ; la Déclaration universelle des Droits de l’homme, Sixième Préambule ; PIDCP, Article 2 ;
ICESCR, Article 2 ; Déclaration de l’ONU sur le Droit au Développement, Article 6 ; Déclaration des Défenseurs de l’ONU, Article 2. 10 Le Comité sur les Droits de l’Homme du PIDCP a aussi souligné l’obligation de l’Etat dans l’Observat ion générale 31(7) (2004) : « En
vertu de l’article 2, les Etats parties doiv ent prendre des mesures d’ordre législatif, judiciaire, administratif, éducatif et autres mesures
appropriées pour s’acquitter de leurs obligations juridiques. » 11 L’Article 4 autorise les Etats « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’exis tence de la nation » de « prendre, dans la
stricte mesure où la situation l’exige, des mesures dérogeant aux obligations prévues dans le présen t Pacte, sous réserve que ces
mesures ne soient pas incompatibles avec les autres obligations que leur impose le droit international et qu’elles n’entraînent pas une
discrimination fondée uniquement sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion ou l’origi ne sociale. » 12 S’il n’est contraignant que pour les signataires du PIDCP, il existe des arguments fort s en faveur de son application plus large. En
tant que membre des Nations Unies, chaque gouvernement a accepté ses obligations de protéger les dro its garantis par le droi t
international, y compris la Déclaration universelle et le PIDCP, entre autres. Un Etat n’a jamais cherché à adhérer à l’ONU en émettant
des réserves à l’égard des Articles 55 et 56 de la Charte, à travers lesquels l es Membres s’engagent à agir conjointement et
séparément, pour promouvoir « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales pour tous, sans
distinction de race, de sexe, de langue ou de religion . » Des huit Etats qui se sont abstenus de voter à l’Assemblée générale de 1948,
Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Article 22:
L’exercice de ce droit [de s’as socier librement avec les autres] ne peut faire l’objet que des seules
restrictions prévues par la loi et qui sont nécessaires dans une société démocratique, dans l’intérê t de la
sécurité nationale, de la sûreté publique, de l’ordre public , ou pour protége r la santé ou la moralité
publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Le présent article n’empêche pas de soumettre à de s
restrictions légales l’exercice de ce droit par les membres des forces armées et de la police .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 11
Autrement dit, sauf dans les situations de danger public, les restrictions à l’exercice de la liber té
d’ass0ociation ne se ju stifient que lorsqu’elles :
(a) Sont prescrites par la loi ;
(b) S’insèrent dans le cadre d’un des quatre intérêts légitimes de l’Etat :
Sécurité nationale ou sûreté publique ;
Ordre public ;
Protection de la santé ou de la moralité publiques ;
Protection des droi ts et libertés des autres ; et
(c) Sont nécessaires dans une société démocratique.
seule l’Arabie saoudite n’a pas renoncé à son abstention. (Forsy the, David, Human Rights Fifty Years after the Universal Declaration,
PS: Political Science and Politics, Tome 31, No 3 (sep. 1998).
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 12
Pour soutenir la conformité aux instruments des droits de l’homme de l’ONU, cette dernière a mis en place un
certain nombre de mécanismes de protection. Par exemple, le Comit é sur les Droits de l’homme 13 a été créé
pour aider à assurer la conformité des Etats au Pacte international sur les Droits civils et politiq ues et est
habilité à accepter des plaintes individuelles de violations présumées. 14 La Procédure de 1503, fondée su r une
résolution de la Commission des Droits de l’Homme de l’ONU de 1970, est conçue pour les plaintes qui
semblent révéler « un ensemble de vio lations des droits de l’homme flagrantes et systématiques et dont on a
des preuves dignes de foi qui lui sont envoyées par des individus ou des ONG . »15 « Procédures spéciales » se
réfère aux mécanismes utilisés par le Conseil des Droits de l’homme pour traiter des situations spéc ifiques au
sei n des pays ou des questions thématiques ; les procédures spéciales peuvent se référer à un individu (ex., le
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU pour les Défenseurs des droits de l’homme) ou à un
groupe de travail. 16 Aucun de ces mécanismes ne peut émettre des décisions juridiquement contraignantes
obligeant les Etats à se conformer mais la force politique et morale des décisions peut avoir une in cidence
considérable sur le comportement des Etats. 17 Par exemple, les déclarations des organes cr éés en vertu des
instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et des comités de contrôle de l’applicatio n sont
utilisées de plus en plus par la société civile pour identifier et blâmer les gouvernements ; il s’a git d’une
tendance importante du recours de la société civile aux mécanismes internationaux.
13 Il ne faut pas confondre le Comité des Droits de l’homme avec la Commission des Droits de l’homme, t rès en vue et enchâss ée dans
la Charte, ou son successeur le Conseil des Droits de l’homme. Tandis que la Commission des Droits de l’homme était un forum
politique où les Etats discutaient toutes les questions liées aux droits de l’homme (remplacée dans cette fonction par le Conseil depuis
juin 2006), le Comité des Droits de l’homme est un mécanisme de traité qui ne concerne que le PICDP. 14 Des informations supplémentaires sur la procédure de plainte individuelle sont disponibles ici. 15 Voir les Défenseurs en première ligne à https://www.frontlinedefenders.org/manual/en/udhr_m.htm ; plus récemment, une nouvelle
procédure de plainte a été instaurée r elativement à la procédure 1503 : https://www2.ohchr.org/english/bodies/chr/complaints.htm . 16 Informations supplém entaires sur les procédures spéciales, y compris les Rapporteurs spéciaux de l’ONU et le Rapporteur spécial d e
l’ONU sur les Défenseurs des Droits de l’homme qui accepte des communications urgentes. 17 La force politique et morale du droit international e st généralement incertaine. Voir Eric Neumayer, Do International Human Rights
Treaties Improve Respect for Human Rights? Journal of Conflict Resolution, Tome 49, No 6, 925 -953, © 2005 Editions SAGE (« Comme
suite à la Déclaration universelle des Droits de l’homme non contraignante, plusieurs traités mondiaux et régionaux relatifs aux droits
de l’homme ont été conclus. Les critiques soutiennent qu’il est peu probable que ces derniers aient changé quelque chose en réal ité.
D’autres prétendent que les régime s internationaux peuvent améliorer le respect des droits de l’homme dans les Etats parties,
notamment dans les pays les plus démocratiques ou ceux ayant une société civile forte consacrée aux droits de l’homme et ayan t des
liens transnationaux. Les conclus ions suggèrent que la ratification des traités ne produit que rarement des effets inconditionnels su r
les droits de l’homme. En revanche, l’amélioration des droits de l’homme est généralement plus proba ble dans les pays les plu s
démocratiques et ceux dont les citoyens participent à plusieurs organisations non -gouvernementales internationales. Inversement,
dans les régimes très autocratiques ayant une société civile faible, la ratification ne produit géné ralement pas d’effet et e st parfois
associée à des vio lations supplémentaires des droits. »)
Pacte international relatif aux droits civils et politiques , Article 2:
1. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter et à garantir à tous les individus se
trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent
Pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion,
d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de
naissance ou de toute autre situation .
2. Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à pr endre, en accord avec leurs procédures
constitutionnelles et avec les dispositions du présent Pacte, les arrangements devant permettre
l’adoption de telles mesures d’ordre législatif ou autre, propres à donner effet aux droits
reconnus dans le présent Pact e qui ne seraient pas déjà en vigueur .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 13
Le code de droit international relatif aux droits de l’homme a été renforcé et dans plusieurs cas co mplété par
des instruments régionaux relatifs aux droits de l’homme où sont aussi sauvegardées les libertés d’association
et d’expression. Selon le pays et l’instrument régional correspondant, les individus et OSC dont les droits ont
été violés peuvent y recourir . Parmi les principaux instruments régionaux 18 on peut citer :
La Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. 19
La Convention américaine relative aux droits de l’homme. 20
La Déclaration américaine des droits et devoirs de l’homme. 21
La Charte arabe des droits de l’homme. 22
La Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homm e et des libertés fondamentales. 23 Afin
de sauvegarder les droits compris dans ces chartes et conventions, des mécanismes de protection ont été
instaurés, y compris la Commission interaméricaine des droits de l’homme et la Cour interaméricaine des
Droits de l’homme ; la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et la Cour européenne des
Droits de l’homme. Tandis que toute personne ou groupe de personnes et toute entité non -gouvernementale
et légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation [des Etats américains], peuvent
soumettre à la Commission interaméricaine des plaintes relatives à une violation de la Convention am éricaine
par un Etat partie, seuls les Etats parties et la Commission ont qualité pour saisir la C our interaméricaine. 24 En
revanche, les individus et les organisations non -gouvernementales peuvent saisir la Cour africaine s’ils ont été
reconnus comme ayant le statut d’observateur ; en revanche, si l’Etat n’a pas opté pour reconnaître la
compétence de l a Cour, dans le cas d’une affaire portée par une entité individuelle, la Cour ne peut pas
recevoir de requêtes contre l’Etat. 25 La Cour européenne va le plus loin en autorisant explicitement les
individus, groupes d’individus et organisations non -gouverneme ntales prétendant être des victimes de
violations des droits de l’homme à saisir la Cour.
De la Déclaration universelle des Droits de l’homme (1948) à la Déclaration sur les Défenseurs des Droits de
l’homme (1999) en passant par le Pacte international su r les Droits civils et politiques (1976), la reconnaissance
de l’importance de l’activité de la société civile s’enracine de plus en plus dans le droit internat ional. Toutefois,
18 Au moment de la rédaction, il n’existe pas de traité r égional des droits de l’homme pour l’Asie . Toutefois, il est important de noter
que le 20 novembre 2007, les leaders de l’Asie du sud -est ont adopté la Charte de l’ASEAN, qui expose une série de règles communes
régissant les négociations commerciales, les investissements, l’environnement et d’autres domaines ; la Charte envisage notamment la
création d’un organe régional des droits de l’homme. Plus récemment, le 20 juillet 2009, le mandat de la Commission
intergouvernementale des Droits de l’homme de l’ASEAN (AICHR) a été approuvé à l’occasion de la 42 e réunion des Ministres des
Affaires étrangères de l’ASEAN en Thaïlande. L’AICHR devrait être opérationnelle à la fin de 2009. (De plus , il convient de noter
l’existence d’une « charte du peuple » sur les droits de l’homme, déclarée officiellement le 17 mai 1998 , mais il ne s’agit ni d’un traité ni
d’une convention.) 19 Entrée en vigueur le 21 octobre 1986 ; adoptée par la dix -huitième Assemblée des Chefs d’Etat et de gouvernement en juin 1981, à
Nairobi, Kenya. Actuellement, 53 Etats sont parties à l a Charte. 20 Entrée en vigueur le 18 juillet 1978 ; adoptée lors de la Conférence spécialisée interaméricaine des Droits de l’homme ,
San José, Costa Rica, le 22 novembre 1969. Actuellement 24 Etats sont parties à la Convention. 21 Approuvée par la Neuvième Conférence internationale des Etats américains, Bogotá, Colombie, 1948.
22 Adoptée par le Conseil de la Ligue des Etats arabes d ans sa résolution 5437 (102 e session régulière) le 15 septembre 1994. 23 Entrée en vigueur le 3 septembre 1953 ; adoptée le 4 novembre 1950 par les membres du Conseil de l’Europe à Rome. 24 La question de saisir la Commission et la Cour interaméricaine est abordée dans les Articles 44 et 6 1 respectivement de la Co nvention
américaine relative aux Droits de l’homme. 25 Protocole portant création d’une Cour africaine, art 5(3), art. 34 (6). Le Protocole prévoit une juridiction facultative pour recevoir les
requêtes introduites par des individus ou organisations non -gouvernementales dotés du statut d’observateur. Afin que la Cour puisse
recevoir les requêtes de ces entités individuelles, l’Etat faisant l’objet de la requête doit d’abord avoir reconnu cette compétence au
moment de la ratification ou à un moment ultérieur. La Cour ne reçoit aucune requête contre les Etat s qui n’ont pas opté pour
accepter cette compétence de la Cour. Il con vient de noter, toutefois, qu’au moment de la rédaction, la Cour africaine ne fait que
commencer à recevoir des requêtes.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 14
les contours précis des droits découlant du droit international et concernant les OSC sont sujets à des
discussions et débats continus.
D’une part, les droits établis par les dispositions des traités s’appliquent, de par leur langage, a ux individus et
non pas aux personnes morales. Le droit international pr otège explicitement le droit des individus de créer
des syndicats et d’autres formes associatives, mais il n’y a pas de langage spécifique abordant les droits de ces
formes associatives une fois ces dernières établies. Les syndicats sont une exception nota ble car ils sont
explicitement protégés dans une série de traités multilatéraux. 26
D’autre part, il existe des arguments forts pour soutenir le concept selon lequel les organisations de la société
civile sont généralement sujettes aux protections accordé es par le droit international :
26 Voir La liberté syndicale et la protection du droit syndical (OIT No 87) , 68 R.T.N.U 17, entrée en vigueur le 4 juillet 1950 ; Conv ention
sur le droit d’organisation et de négociation collective (OIT No 98), 96 R.T.N.U 257, entrée en vigueur le 18 juillet 1951 ; Convention
concernant les Représentants des Travailleurs (OIT No 135) , 883 R.T.N.U 111, entrée en vigueur le 30 juin 1973 ; Convention sur les
Relations de travail dans la Fonction publique (OIT No 151) , 1218 R.T.N.U 87, entrée en vigueur le 25 février 1981.
Observations finales du Comité des Droits de l’homme ( PIDCP )
Le Comité des Droits de l’homme , en passant en revue les plaintes individuelles contre les Etats
suivants, a exprimé sa préoccupation dans les « observatio ns finales » à l’égard de la protection du
droit à la liberté d’association . Une liste des pays et des questions de préoccupation se trouve ci -après
à titre indicatif . [Des détails supplémentaires sont disponibles ici] :
Mongolie , PIDCP, A/47/40 (1992) : absence de mécanismes adéquats pour faire appel de décisions administrativ es.
Estonie , PIDCP, A/51/40 tome I (1996) : limitations à l’exercice de la liberté d’association pour les rési dents
permane nts à long terme.
Liban , PIDCP, A/52/40, tome I (1997) : restriction imposée au droit à la liberté d’association à travers un processus
de licence et de contrôle préalables.
Slovaquie , PIDCP, A/52/40 tome I (1997) : exigence que les associations et ONG soi ent enregistrées afin de
fonctionner librement et conditions préalables restrictives à l’enregistrement.
Biélorussie , PIDCP, A/53/40 tome I (1998) : difficultés liées aux procédures d’inscription auxquelles sont soum is les
ONG et les syndicats.
Koweït , PI DCP, A/55/40 tome I (2000) : incapacité de la Société koweitienne des Droits de l’homme de
s’enregistrer en tant qu’association depuis 1992.
Syrie , PIDCP, A/56/40 tome I (2001) : restrictions à l’établissement d’associations privées, y compris le s ONG et l es
organisations des droits de l’homme.
Vietnam , PIDCP, A/57/40 tome I (2002) : obstacles à l’enregistrement et au libre fonctionnement des organis ations
non -gouvernementales des droits de l’homme.
Egypte , PIDCP, A/58/40 tome I (2003) : restrictions imposé es aux efforts des ONG pour obtenir un financement
étranger.
Togo , PIDCP, A/58/40 tome I (2003) : incapacité des organisations non -gouvernementales des droits de l’homme
de s’enregistrer.
Fédération de Russie , PIDCP, A/59/40 tome I (2003) : la d éfinition d u terme « activité extrémiste » dans la
législation fédérale est trop vague pour protéger les individus et associations contre son applicati on arbitraire.
Colombie , PIDCP, A/59/40 tome I (2004) : mesures prises à l’encontre des défenseurs des droits de l’ homme, y
compris l’intimidation et les attaques physiques, ainsi que l’interception de communications.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 15
(1) Plusieurs droits sauvegardés dans le PIDCP et les autres instruments des droits de l’homme de l’ONU
peuvent être exercés individuellement ou en association avec autrui. Comme l’explique le Comité des
Droits de l’homme du PID CP dans l’Observation générale No 31 (2004) : « les bénéficiaires des droits
reconnus par le Pacte sont les individus. Bien que … le Pacte ne mentionne pas les droits des
personnes morales ou entités ou collectivités similaires, plusieurs droits reconnus p ar le Pacte, tels que
… le droit à la liberté d’association … peuvent être exercés collectivement avec autrui . Le fait que la
compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications soit restreinte aux seules
communications soumises par un indivi du ou au nom d’un individu (article 1 du Protocole facultatif)
n’empêche pas un tel individu de faire valoir que les actions ou omissions affectant des personnes m orales
et entités similaires constituent une violation de ses propres droits. » (notre soulig né). En effet, le
Représentant spécial de l’ONU sur les Défenseurs des Droits de l’homme, dans des rapports au
Secrétaire général, se réfère aux droits des ONG (« les ONG ont le droit de s’enregistrer comme des
personnes morales » ou « les gouvernements d oivent permettre aux ONG d’accéder au financement
étranger »). 27
(2) La Convention européenne des Droits de l’homme (CEDH) a reconnu à « toute personne physique,
toute organisation non gouvernementale ou tout groupe de particuliers qui se prétend victime d’une
violation »28 le droit de présenter une requête à condition de remplir les critères d’admissibilité. Nous
pouvons en déduire qu’au moins certains des droits fondamentaux de la Convention européenne
concernent aussi les ONG. Cela n’aurait pas de sens d’éta blir le droit de porter plainte à moins qu’il
n’existe de droits fondamentaux sous -jacents. On doit donc présumer que les références dans la
CEDH à « tout le monde » peuvent correspondre en principe aux personnes naturelles et morales, y
compris les ONG. Bien entendu, certains droits fondamentaux, de par leur nature, ne s’appliquent pas
aux personnes morales, tels que le droit à la vie, à la liberté et à la sûreté personnelles, à la vi e familiale
et au mariage. Reconnaissant que les ONG n’ont aucune com pétence pour soumettre des requêtes
représentatives (c. -à-d. invoquer des droits qui protègent leurs membres), les ONG ne peuvent
qu’invoquer les droits qui s’appliquent à elles. 29
(3) Il existe un droit similaire de porter plainte dans d’autres mécanismes régi onaux des droits de
l’homme, contribuant ainsi à un consensus croissant dans le cadre juridique international sur le fai t que
les ONG jouissent de droits qui peuvent être violés et défendus. En vertu de l’Article 44 de la
Convention américaine relative aux Droits de l’homme, on reconnaît aussi aux ONG le droit de porter
plainte : « toute personne ou tout groupe de personnes, toute entité non gouvernementale et
légalement reconnue dans un ou plusieurs Etats membres de l’Organisation peuvent soumettre à la
Co mmission des pétitions contenant des dénonciations ou plaintes relatives à une violation de la
présente Convention par un Etat partie. »30 Comme signalé ci -dessus, la Cour africaine nouvellement
cré ée permet aux individus et aux organisations non -gouvernem entales de soumettre une pétition s’ils
ont été reconnus comme ayant le statut d’observateur.
27 Rapport soumis par la Représentante spéciale du Secrétaire général de l’ONU sur les défenseurs des droits de l’homme , Hina Jilani,
conformément à la Résolution 58/178 de l’Assemblée générale, pages 21 -23. 28 Protocole 11 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. 29 Erik Denters et Wino J.M. van Veen, Voluntary Organizations in Europe : The European Convention on Human Rights , International
Journal for Not -for -Profit Law, Tome 1, Numéro 2 (décembre 1998). 30 Convention américaine relative aux Droits de l’homme, Article 44. Toutefois, l’Article 61 limite le droit de saisir la Cour
interaméricaine aux Etats parties et à la Commission interaméricaine elle -même.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 16
(4) Plusieurs décisions de la Cour européenne des Droits de l’homme 31 confirment les droits et le statut
des ONG en vertu de la Convention européenne (voir encadré). 32 Spécifiquement, la Cour européenne
a fermement établi l’existence, dans le droit international, d’un droit de fonder des associations
légalement enregistrées et qu’une fois fondées, ces organisations ont droit à des protections
juridique es générales. 33 Cela a été mis à l’essai par les partis politiques et autres associations en
Turquie et ailleurs. Dans le Parti communiste unifié de Turquie et autres contre la Turquie (« UCP »), la
Cour a statué que « la protection accordée en vertu de l’Article 11 [libe rté d’association] s’étend sur la
vie entière d’une association et que la dissolution d’une association … doit de ce fait satisfaire l es
conditions du paragraphe 2 de cette disposition …” 34 Dans l’affaire du Parti de la Liberté et de la
Démocratie (ÖZDEP) contre la Turquie , la Cour a affirmé le lien entre la liberté d’association et la
liberté d’expression (Article 10 de la CEDH) : « l’Article 11 doit aussi être examiné en rapport avec
l’Article 10. La protection des opinions et la liberté d’expression des dites opinions est un des objectifs
des libertés de rassemblement et d’association sauvegardées dans l’Article 11. Cela s’applique
d’autant plus aux partis politiques, eu égard au rôle essentiel joué par ces derniers en assurant le
pluralisme et la démoc ratie. »35 En concluant dans les affaires UCP et ÖZDEP que la protection
accordée en vertu de l’Article 11 s’étend sur toute la vie d’une association, la Cour a essentiellem ent
conféré aux personnes morales les protections du droit à la liberté d’associati on. 36
31 Parmi toutes les cours régionales, la Cour européenne a le code de jurisprudence le mieux développé dans l’interprétation des
questions de liberté d’association. La Cour interaméricaine relativement jeune a statué sur très peu de cas liés à la liberté d’association
et la Cour africaine, qui n’est devenue opérationnelle que récemment n’a pas encore statué sur des c as de liberté d’associat ion. 32 Pour une analyse détaillée de la jurisprudence concernant la libe rté d’association, voir Zvonimir Mataga, The Right to Freedom of
Association under the European Convention on the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms , © Octobre 2006, Centre
européen de droit des associations à but non lucratif. 33 Voir par exemple Sidiropoulos and others v. Greece , jugement du 10 juillet 1998, Rapports des Jugements et Décisions 1998 -IV ; United
Communist Party of Turkey and others v. Turkey , jugement du 30 janvier 1998, Rapports 1998 -I. 34 UCP, Cour européenne des Droits de l’homme, (133/1996/752/951) (Décision de la Chambre haute, 30 janvier 1998) (« Le droit garanti
par l’Article 11 serait largement théorique et illusoire s’il était limité à la création d’une asso ciation étant donné que l es autorités
nationales pourraient immédiatement dissoudre l’association sans devoir se conformer à la Convention. Il s’ensuit que la protection
accordée par l’Article 11 dure toute la vie d’une association et que la dissolution d’une associatio n par les autorités d’un pays doit
satisfair e les conditions du paragraphe 2 de cette disposition. . . . »)
35 OZDEP, Cour européenne des Droits de l’homme, (93 1998/22/95/784) (Décision de la Chambre haute, 8 d écembre 1999). 36 Leon Irish et Karla Simon, Recent Developments regarding the “Neglected R ight”, International Journal for Not -for -Profit Law, Tome
3, Numéro 2 (décembre 2000).
Cour européenne des Droits de l’homme
Parmi les dé cisions notables ayant trait à la liberté d’ association on peut citer :
Parti communiste unifié de Tur quie et autres contre la Turquie (30 janvier 1998)
Parti socialiste et autres cintre la Turquie (25 mai 1998)
Sidiropoulos et autres contre la Grèce (10 juillet 1998)
Parti de la Liberté et de la Démocratie (OZDEP) contre la Turquie (8 décembre 1999)
Stank ov et l’Organisation macédonienne unie « Ilinden » contre la Bulgari e (2 octobre 2001)
Refah Partisi et autres contre la Turquie (13 février 2003)
Gorzelik et autres contre la Pologne (17 février 2004)
Branche de Moscou de l’Armée du Salut contre la Russi e (5 octobre 2006)
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 17
Somme toute, la position que les OSC en tant que personnes morales exerçant la liberté d’association
jouissent de droits propres est de plus en plus viable. En raison de la jurisprudence de la Cour eu ropéenne,
l’argument est le plus fort dans le contexte européen, mais peut aussi être défendue plus largement.
Toutefois, l’utilité de ces arguments, dépendra probablement du cadre national dans lequel fonctionn ent les
OSC.
B. Cadre juridique et réglementai re national affectant les OSC
La pertinence et l’ impact des lois internationales varient d’un pays à l’autre .37 Les organisations de la soci été
civile fonctionnent au sein d’un cadre créé par les réglementations et le droit national de chaque pays . Le
cadre global au niveau national po ur la plupart des pays est la constitution , bien que souvent il existe un
décalage énorme entre la rhétorique constitution nelle et les pratiques réelles . A partir du contexte
constitution nel , le cadre juridique au niveau national peut être composé de lois et de règlements , de décrets
et de directives administratives, ainsi que de décisions judicia ires interprétant cet ensemble de lois . Le droit
national est souvent barré , au moins par écrit , par les limites des instruments juridiques internationaux
applica ble s, bien que ce ne soit pas systématiquement toujours le cas en pratique . Bien entendu , les contours
précis du cadre juridique varient considérablement d’un pays à l’autre et dépendent d’une grande var iété de
facteurs . Les sections ci -dessous examinent certaines des caractéristiques les plus fréquentes des cadres
juridiques et de réglementation touchant la société civil e.
1) Constitution
Les libertés fondamentales liées à l’ opinion, l’expression, le droit de réunion et d’ association sont souvent
codifiées dans les constitutions nationales . Les droits de la personne codifi és au niveau national en tant que
droits constitutionnels ou fondament aux garantissent une protection contre les interventions arbitra ires de la
part de l’Etat mais donnent également certa ines obligations à l’Etat quant au devoir de respecter et de
protéger ces droits en ce qui concerne des tierces parties . Le libellé exact de ces protections
constitutionnelles peut varier d’un pays à l’autre . Dans certains pays , les libertés fondamentales concernent
seulement les citoyens , mais s’étendent également de manière plus large dans d’autres pays aux non
ressortissants .38 Dans la plupart des pays , les libertés fondamentales d’ association et d’ expression ne sont pas
absolue s ; les constitutions défi nissent parfois des limites spécifiques dans le vocabulaire de la constitution
elle -même . Des exemples s pécifi ques de vocabulaire constitution nel applicable à la liberté d’ association en
particul ier apparaissent dans l’encadré qui suit .
Même si les constit utions contiennent un libellé habilitant , elles sont souvent affaiblies par le biais de lois et de
règlements sous -constitutionnels inhabilitants ou inad équat s, o u par une mise en œuvre de mauvaise qualité
ou inad éq uate. Un exemple parmi d’autres: la Corée du Nord qui prot ège le droit d’a ssociation libre dans sa
con stitution ( « Les citoyens ont le droit à la liberté d’expression , de la presse , de réunion , de manifestation et
d’a ssociation »39), mais pas en pratique .40 C’est le cadre des lois sous -constitution nelles – y compris, bien
37 Le système juridique international suppose que l’état de droit international s’applique au droit nat ional. Cependant, comme
beaucoup de règles internationales ne peuve nt être effectivement appliquées que par le biais de mécanismes juridiques nationaux, le
point de vue du droit national quant à la mise en œuvre de ce même droit international est importan t. Il existe deux courant s de
pensée traditionnels sur cette quest ion. Le monisme avance que toute loi s’inscrit dans un ordre légal universel, et que par conséquent
le droit international s’applique automatiquement au sein de l’ordre légal national. Le dualisme est la théorie selon laquell e le droit
international et le droit national sont des ensembles juridiques distincts. Les règles du droit international doivent pa r conséquent être
intégrées au droit national avant de devenir effectives dans une quelconque juridiction.
38 Par exemple, la Bulgarie et la Roumanie étenden t la protection constitutionnelle de ces libertés à leurs citoyens uniquement, mais la
République tchèque, la Hongrie, la Pologne et la Slovaquie les étendent de manière plus large à tout le monde.
39 Article 67, Constitution de la République démocratique p opulaire de Corée, amendée et adoptée le 5 septembre 1998.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 18
entendu , l’accès des citoyens et la compréhension de ces lois ainsi que leur mise en œuvre pratique – qui, dans
la plupart des cas , d étermine la portée réelle et le sens véritable de la libre association.
2) Lois et règlements sous -co nstitutionnels
Au sein du cadre constitution nel , le système législatif et réglementaire est compos é de lois et de règlements
qui gouvernent les différentes formes d’OSC , et peut aussi inclure les décrets et les directives administratives ,
ainsi que les déc isions judiciaires . En effet , c’est le cadre juridique sous -constitutionnel qui définit les formes
organisationnelles que la société civile peut adopter .
Quel que soit le nombre de variantes d’OSC sous -jacentes , le cadre juridique traitera en général 41 un e variété
étendue de questions liées au cycle de vie d’une OSC , au traitement fiscal des OSC , aux relations entre l’Etat et
le secteur civil , et à la participation publique . Il n’est pas étonnant qu’il n’existe pas une loi unique couvrant
l’ensemble de ces questions variées.
40 Le Rapport du ministère des Affaires étrangères des Etats -Unis sur les Pratiques en matière de Droits humains en Corée du Nord
(2006 ) déclare comme suit : « La constitution garantit la liberté d’association ; néanmoins, le gouvernement n’a pas réussi à mettre
cette clause en pratique. Il n’existe aucune autre organisation que celles créées par le gouvernemen t. Les associations profe ssionnelles
existent principalement afin de faciliter le contrôle et la surveillance par le gouvernement des me mbres de l’organisation. » 41 Les rapports sur les lois et le pays ont été compilés dans plus de 150 pays et analysés afin d’évalu er les pratiques internationales en
vigueur. Vous pouvez trouver des informations sur divers pays sur ICNL .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 19
Protections constitutionnelles
Argentine Art. 14 : On garantit à tous les habitants du pays la jouissance des droits suivants,
conformément aux lois qui règlementent cet exercice, c’est -à-dire : le droit d’association pour une
raison v alable.
Brésil : Art. 5 (XVII) : la liberté d’of association pour des raisons légales est pleinement garantie
mais toute association paramilitaire est proscrite.
République populaire de Chine : Article 35. Liberté d’expression, de la presse, de réunion : les
citoyens de la République populaire de Chine jouissent de la liberté d’expression, de la presse, de
réunion, d’association, de défilé et de manifestation.
Inde : Article 19(1) (c) : tous les citoyens ont le droit de former des associations ou syndicats .
Indonésie : Le deuxième amendement à la Constitution de 1945 garantit la liberté d’association
(Article 28) et la liberté d’expression (Article 28E section (3)). La Co nstitution déclare cependant
également que ces droits peuvent être limités afin de « satisfaire des demandes valables basées sur
des considérations de moralité, de valeurs religieuse, de sécurité et d’ordre public dans une sociét é
démocratique » (Article 28J section (2)).
Mexique : Article 9 : Le droit de réunion ou d’association pacifique pour toute raison légale ne peut
être limité ; mais seuls les citoyens de la République peuvent faire cela en ce qui concerne les
affaires politiques du pays. Aucune ré union de délibération armée ne sera autorisée.
Nigeria : Art. 40 : Toute personne aura le droit de libre assemblée et d’ association avec d’autres
personnes, et pourra en particulier former ou appartenir à un parti politique, syndicat ou toute
autre associa tion pour la protection de ses intérêts, à partir du moment où les clauses de cette
section n’iront pas à l’encontre des pouvoirs conférés par cette Constitution à la Commission
électorale nationale indépendante en ce qui concerne les partis politiques non reconnus par cette
même Commission. Art 45 : (1) Rien dans les sections 37, 38, 39, 40 et 41 de cette Constitution ne
pourra invalider une loi qui soit raisonnablement justifiable dans une société démocratique (a)
dans l’intérêt de la défense , de la sécur ité publique, de l’ordre public, de la moralité publique ou de
la santé publique ; ou (b) pour protéger les droits et la liberté d’autres personnes .
Philippines : SEC. 8 : Le droit des individus, y compris ceux employés dans les secteurs public et
privé , à former des syndicats, associations ou sociétés pour des raisons non contraires à la loi ne
pourra être limité.
Afrique du Sud : Art 18 : Chacun a le droit à la liberté d’association.
Ouganda : Art V (ii) : l’Etat garantira et respectera l’indépendance des organisations non
gouvernementales qui protègent et promeuvent les droits humains.
Vietnam : Art 69 : Le citoyen devra jouir de la liberté d’opinion et d’expression, de la liberté de la
presse, du droit à l’information et du droit de réunion, de former de s associations et d’organiser
des manifestations conformément aux conditions de la loi.
On peut noter que la Constitution de 1992 du Monténégro garantit aux « groupes nationaux et
ethniques le droit de créer des associations pédagogiques, culturelles et re ligieuses, avec le soutien
financier de l’Etat » (accent ajouté) (Article 70, Constitution du Monténégro, 1992).
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 20
Au lieu de cela , et selon le pays et les traditions juridiques , il est probable qu’il existe un réseau complexe de
sources juridiques pouvant inclure des clauses du code civil , des lois liées aux différentes formes
organisationn elles , des lois fiscales , le droit du travail , le droit pénal , ainsi que des règlements, décrets et
même des décisions des tribunaux qui auront une influence directe ou indirect e sur l’ existence, le
fonctionnement et les activit és des OSC.
Le graphique suivant (page 20) illustre certaines des questions couramment réglementées , divi sées e n quatre
(4) groupes (col onne 1), et les divers règlements et lois dans le cadre juridique qui gouvernent chaque groupe
de questions (col onne 2).
C. Identifier les élém ents du Droit des associations de la Société civile
Le cadre juridique et de réglementation traite toute une gamme de questions fondamental es , telles que celles
suggérées ci -dessus : le cycle de vie d’une OSC , le traitement fiscal réservé aux OSC , les rela tions entre l’Etat et
le secteur civil et la participation publique . Dans cette section, nous allons examine r certaines des questions –
clés du cycle de vie d’une OSC .
Caract éristi ques d’une OSC
Comme on l’a dit précédemment , il existe une gamme étendue de formes organisationnelles juridique es . Les
ONG affiliées aux religions ne sont pas placées dans une catégorie particulière à partir du moment où elles
sont créées comme organi sations séculaires à but non lucratif . En effet, la bonne pratique international e veut
qu’on ne leur impose pas de régime réglementaire particulier . De cette manière , les ONG à vocation religieuse
sont simplement soumises aux mêmes règles applicables aux autres organi sations à but non lucratif .42
Quelle que soit leur forme organisati onnelle , cependant , toutes les OSC (comme elles sont définies dans le
cadre d u Guide ) partagent une caractéristique fondamental e : le principe de non -redistribution . Le principe de
non -redistribution est la caractéristique la plus important e qui distingue les OSC des organisations à but non
lucratif . Ce principe interdit la distribution des recettes nettes , des biens ou des profits à un fondateur,
directeur , responsable, membre, employé ou donateur d’une OSC . Ainsi , cette contrainte cherche à garantir
que t ous les biens, recettes et profits seront utilisés pour soutenir les objectifs à but non lucratif de l’OSC . Bien
évidemment , ce principe n’empêche en aucune manière le paiement d’une compensation raisonnable pour
42 Pour de plus amples informations sur les normes internationales et les rapports de pays liés à la liberté de religion, voir le Bureau du
Haut -commissariat des Nations Unies aux Droits de l’Homme et le Conseil consultatif du BIDDH/ OSCE sur la liberté de religion et de
conviction . Veuillez également consulter cette base de données sur les textes législatifs et autres documents sur cette question.
Form es organisationnelles (liste à titre d’information seul ement)
Association : basée sur des membres
Fondation : pas de membres, souvent bas ées sur un capital
Société à but non lucratif : sociétés limitées par le principe de non -redistribution
Société de gestion fiduciaire : instrument juridique utilisé pour mettre de côté l’argent ou les biens d’une
personne au bénéfice d’une ou plusieurs personnes ou d’ organi sations
Oeuvre caritative : forme juridique pour les organisations de bénévoles co urantes en Grande -Bretagne et
dans certains pays du Commonwealth.
Formes spécialisées : sociétés d’intér êt public , fonds, centr es/instituts, soci étés, o rgani sations humanitaires
etc.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 21
services rendus .43
43 Pour en savoir plus sur le principe de n on-redistribution, voir le UN Nonprofit Handbook Project (Guide de l’ONU pour les associations
à but non lucratif), Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, © 2003 United Natio ns, pages 16 -18 ; Guidelines for Laws Affecting
Civic Organizations , by Leon Irish, Robert Kushen, Karla Simon, © 2004 Open Society Institute, page 48.
Questions générales au sujet du cycle de vie :
Définition du mode organisationnel de l’OSC ;
Création ;
Enregistrement ;
Structure et gouvernance internes ;
Activi tés ;
Contrôle externe, y compris la soumission de
rapports et des comptes ;
Fin de contrat, dissolution et liquidation ;
Organisations civiles étrangères.
Réglementées potentiellement par :
Le Code civil ;
Une législation spécifique gouvernant les divers
types d’organisation (lois sur les associations et
fondations, par exemple)
Législation gouvernant les différents types de
sociétés ;
Lois sur les relations professionnelles (liées aux
syndicats).
Lois sur l’autorisation d’exploitation (pour certain s
types d’activités)
Réglementation fiscale des OSC :
Statut d’intérêt public (ou caritatif) ;
Exemptions d’impôts sur les revenus ou les
profits pour les OSC ;
Statut préférentiel en matière d’impôt sur les
revenus et les profits quant aux dons ;
Activit és économiques et taxation des revenus
de ces activités économiques ;
TVA et droits de douane ;
Financement étatique ;
Revenus des investissements ;
Collecte de fonds (collectes publiques).
Réglementée potentiellement par :
Lois sur l’intérêt public ;
Loi s sur l’impôt sur le revenu ;
Loi sur la TVA ;
Loi sur les droits de douane ;
Loi sur la collecte de fonds (collectes publiques) ;
Lois sur les appropriations budgétaires ;
Lois sur le financement et la vérification des
comptes ;
Loi sur le foncier (droits et taxes).
Relations Etat -Secteur civil :
Enregistrement ;
Contrôle externe, y compris soumission de
rapports et reddition de comptes ;
Politique publique et activités politiques
Subventions étatiques, bourses et contrat ;
QUANGO (ONG quasi -auton ome) et GONGO
(ONG gérée par un gouvernement) ;
Documents de politique en matière de
coopération ;
Bureaux de l iaison .
Réglementées potentiellement par :
Toutes les lois et réglementations mentionnées ci –
dessus ;
Lois u le gouvernement local ;
Loi sur les achats publics ;
Lois sur l’aide sociale, la santé, l’éducation ;
Lois créant divers types d’organisations à but non
lucratif, souvent considérées comme QUANGO ou
GONGO ;
Documents de politique en matière de
coopération.
Participation publique :
Politique s publiques et activités politiques ;
Réception d’informations ;
Consultations ;
Participation active.
Réglementée potentiellement par :
Lois sur la liberté d’information ;
Lois sur la transparence décisionnelle
Règles de procédures juridique s ;
Politique gouvernementale.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 22
Pour renforcer le princ ipe de non distribution, le droit national peut également inclure d’autres interdictions :
Avantages personnels . Les avantages personnels ont lieu quand une personne initiée – un individu
ayant une grande influence dans l’ organi sation – passe un accord avec l’OSC et reçoit des bénéfices
plus élevés que ce qu’il fournit en retou r. L’exemple le plus courant est la compensation excessive
mais ceci peut aller jusqu’aux avantages personnels spécifiques, comme des bourses accordées à un
parent.
Interdiction des transactions intéressées . Les transactions intéressées peuvent provenir du fait qu’une
personne initiée s’engage dans une transaction constituant un avantage déraisonnable pour un
individu , souvent au détriment de l’OSC . Par ex emple, le fond ateur d’une OSC pourrait s’arranger pour
que l’OSC achète un bien qui lui appartient à un prix gonflé ou pour acheter un bien à l’OSC pour un
montant inférieur à sa valeur réelle .44
Existence légale
Traditionnellement , le droit définit les crit ères de formation des divers types d’OSC . Ces crit ères varient très
largement selon le type d’ or gani sation, mais souvent ils traitent les mêmes questions, entre autres :
Pour la constitution d’une OSC , quel est le nombre minimum de membres ?
Pour certaines OSC sans système d’adhésion , quel est le montant minimum de l’apport initial ?
Qui peut être fo ndateur d’une OSC ?
Quels objectifs sont permissible s pour l’OSC ?
Quels documents – loi de création , statut, etc. – sont nécessaires pour fonder une OSC ?
Une fois formées , de nombreuses OSC voudront être reconnues en tant qu e personne morale . La
reconn aissance du statut de personne morale peut découler automatiquement de la création (c’est -à-dire ,
simplement comme conséquence du fait d’avoir une constitution écrite ), o u après avoir souscrit à une
procédure de notification simple et totalement volontaire (c’est -à-dire par l’intermédiaire d’une dé claration
auprès d’une agence gouvernementale qui publie ou inscrit dans un registre public les informations
concernant l’or gani sation). C’est le cas pour les a ssociations dans beaucoup de pays européens . Dans de
nombreux autres pays , cependant , le statut de personne morale dépend d’un process us d’enregistrement .
L’enregistrement est parfois obligatoire pour toutes les OSC , mais il est plus traditionnellement volontaire .45
44 Pour plus d’informations sur ces inte rdictions, voir Guidelines for Laws Affecting Civic Organizations , © 2004 Open Society Institute,
pages 47 -51.
45 Pour être cohérent avec les normes légales internationales, l’enregistrement do it être volontaire. Un enregistrement obligatoire, en
particulier accompagné d’amendes pour activités non enregistrées, est presque à coup sûr une violati on des principes de liber té
d’association.
Principe de non -red istribution
Aucune redistribution de revenus nets, de biens ou de profits n’est permis e à tout fondateur , direct eu r,
responsable , membr e, employ é ou donateur de l’OSC .
Au contraire, les biens, revenus et profits seront utilisés pour soutenir les objectifs à but non lucratif de l’OSC .
Ce principe n’empêche en aucune manière le pa iement d’une compensation raisonnable pour services rendus
par les employés ou d’autres au nom de l’OSC , bien que la dé finition du terme « raisonnable » soit à débattre
dans certains cas .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 23
La loi peut donner le pouvoir d’enregist rement à toute une variété d’agences gouvernementales , y compris à
un ministère, aux tribunaux ou à une c ommission indépendante . L’enregistrement en général demande la
présentation de document s comprenant le document de création et le règlement intérieur d e l’ organi sation,
ainsi que la demande . Des lois bien édictées comprennent également un nombre de sauvegardes
procédurières , comprenant :
Un délai fixe et raisonnable pendant l equel le gouvernement peut procéder à une étude des demandes
d’enregistrement ;
Dans certains cas, une règle d’enregistrement par pr ésomption si le gouvernement ne parvient pas à
agir dans le délai fixé ;
Des arguments clairs et objectifs pour les refus d’enregistrement ;
Une notification écrite au demandeur si la décision est négati ve ;
Le droit de faire appel du refus d’enregistrement devant un tribunal indépendant.
La résiliation et la dissolution des OSC sont souvent traitées dans le cadre juridique. La résiliation peut faire
suite à une décision volontaire de la part de l’OSC ou peut être le résultat d’une action du go uvern ement o u
des tribunaux (résiliation non v olonta ire ). Les raisons de la résiliation dans le cadre de lois bien édictées sont
claires, objective s et exhaustive s. Elles peuvent comprendre entre autres :
L’incapacit é à remédier à une violation importante et prolongée de la loi , suite à une notification et à la
possibilité de corriger le problème ;
Déclaration de faillite ;
Inactivi té, souvent mesurée par l’incapacité de soumettre des rapports .
Quels sont les avantages du statut de personne morale ?
Le statut de personne morale confère les avantages suivants à une OSC :
La capacité d’ouvrir un compte en banque, d’employer du personnel et de posséder des biens
en son nom propre.
Une responsabilité personnelle limitée pour les membres du conseil d’administration et le
personnel de l’OSC.
Une position plus forte pour obtenir et garantir des fonds, car les bailleurs de fonds ont
généralement plus confiance en une OSC ayant le statut de personne morale et beaucoup
d’entre eux peuvent uniquement financer des organisations de cette nature.
Quels sont les inconvénients ?
En même temps, il semble qu’il y ait de bonnes raisons pour qu’une OSC ne dé sire pas son
enregistrement (même si cette option n’est pas toujours disponible) :
Les dépenses (préparation des documents, frais d’enregistrement) et le temps passé à remplir la
demande d’enregistrement.
La soumission potentielle de rapports et implicati ons fiscales liées au fait d’être d’être une
personne morale enregistrée.
Si un groupe est de petite taille, ne gère pas d’argent, ne prévoit pas d’activité économique ou
d’attirer des dons ou des subventions, il n’est pas vraiment utile d’être enregistré.
Dans les environnements restrictifs, l’enregistrement peut être vu comme un moyen pour un
gouvernement de surveiller et de contrôler les activités des ONG.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 24
Suite à la dissolutio n de l’ organi sation, les biens sont mis en l iquidat ion et transf érés . Après le paiement des
créanciers, les actifs de l’OSC sont souvent dirigés vers une OSC ayant des objectifs identiques ou similaires .
Dans des cas vraiment exception nels , les biens sont absorbés par l’Etat . L’interdiction de ré version des biens
empêche qu’ils soient réclamés par des personnes membres de l’OSC .
Structure et gouvernance
La s tructure et la go uvernance internes d’une OSC sont définies par des règles provenant d’au moins qu atre
(4) sources différentes 46 :
Conditions légales ;
Normes volontaires fixées par les organismes principaux 47 ;
Bailleurs de fonds et sympathisants d’une OSC ;
Les choix purement discrétionnaires de l’OSC elle -même , exprimés par ses membres , son conseil
d’administration ou tout autre organe délibérant .
Des lois et règlements bien édictés fixent traditionnellement les normes minim ales pour la structure et la
go uvernance de l’ organi sation, tout en laissant de la place à l’OSC pour qu’elle adapt e sa structure selon sa
mission et ses moyens . Il est certain que différentes formes d’OSC auront des structures internes différentes .
Par ex emple, les associations sont en général go uvernées par l’a ssembl ée des membr es, alors que les
fon
dati
ons
son
t
gou
ver
née
s
par
un
con
seil
d’a
dmi
nist
rati
on.
Cec
i
dit ,
cer
tain
es
46 Voir Guidelines for Laws Affecting Civic Organizations , © 2004 Open Society Institute, page 39. 47 Voir la liste des divers codes de déontologie et codes de conduite adoptés par les organisations int ernationales ou les grou pes
nationaux principaux à CIVICUS sur ce lien .
Principes de bonne gouvernance
Les conditions suivantes à définir concernant la « bonne gouvernance » sont parmi les meilleures
pratiques de réglementation comprises dans la législation sur les OSC :
L’instance décisionnelle la plus haute de l’OSC, ses pouvoirs et devoirs, et le nombre minimum
de fois qu’elle doit se réunir chaque année ;
Les autres organes décisionnels, leurs pouvo irs et responsabilités de base, ainsi que leur
relation avec l’instance décisionnelle la plus élevée et les uns avec les autres ;
Devoirs de loyauté, de diligence et de confidentialité applicables aux responsables et
membres du conseil d’administration d’u ne OSC ;
Conditions définissant le niveau de responsabilité des directeurs, responsables, employés de
l’OSC, qui souvent protège ces individus d’une responsabilité personnelle, sauf dans les cas de
négligence intentionnelle ou grave ;
Interdiction de confl its d’intérêt, demandant aux responsables, membres du conseil
d’administration et employés d’éviter tout conflit réel ou potentiel entre leurs intérêts
personnels et professionnels et les intérêts de l’OSC.
Obligation de tenir des registres afin de garant ir que les OSC conservent des archives liées aux
finances et aux activités ;
Obligation de soumettre des rapports en interne, avec la soumission des rapports financiers
et d’activités à l’instance décisionnelle la plus haute pour étude et approbation ;
Int erdiction des avantages personnels et des transactions intéressées.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 25
règles de gouvernance intern e peuvent être largement applicable s à toutes les formes d’OSC .
Activit és des OSC
Une OSC ayant le statut de personne morale a en général les mêmes droits et responsabilités que l es autres
entités légales . Par ex emple, une OSC (avec le statut de personne morale ) est en général capable de signer
des contrats, de posséder des biens immobiliers , d’embaucher , d’avoir un compte en banque , de louer des
bureaux , de poursuivre en justice e t d’être poursuivi , etc., en son nom propre . Les OSC impliquées dans des
activit és soumises à l’obtention d’une licen ce ou à des règlements d’une agence gouvernementales (tels que
dans les domaines de la santé, de l’éducation et des services sociaux ) sont généralement soumises aux
mêmes conditions d’obtention de licence et de permis applicable s aux individus, aux personnes morales et
aux sociétés commerciales . Des règles spéciales peuvent s’appliquer , cependant , à certains domaines
spécifiques d’activité d e l’OSC , en particulier les activités d’utilité publique , les activit és politiques et
économiques .48
La plupart des systèmes de règlementation permettent à certaines organi sations, sur la base de leurs objectifs
et de leurs activités , d’être reconnues com me étant « d’utilité publique » afin de pouvoir recevoir des
avantages particuliers de la part de l’Etat , tels que des avantages fiscaux spécifiques ou le droit de faire des
offres pour certains contrats publics . Selon l’approche réglementaire , les OSC po ursuivant de tels objectifs et
activités peuvent soit bénéficier « d’exemption d’impôts » ou être déclarées comme « organisation
caritatives ». Cette reconnaissance peut être accordée par les autorités fiscales , par un ministère désigné ou
un service minis tériel , par les tribunaux ou par une commission spéciale se prononçant sur ces questions . Les
activités et critères de qualifi cation varient beaucoup d’un pays à l’autre , tout comme les proc édures de
reconnaissance , les avantages connexes et les normes com ptables qui les accompa gnent .49
Dans le monde des activités p oliti ques et de politique publique , les pays adopt ent toute une gamme
d’approches réglementaires différentes . D’habitude , les OSC ont le droit d’entreprendre des activit és de
politique publique , pouvant inclure, entre autres choses , recherche, éducation, plaidoyer et la publication de
rapports sur les politiques . En effet , pour être cohérent par rapport aux normes international es concernant la
liberté d’expression , les OSC peuvent , comme tout individu, parler au sujet de questions d’intérêt public , y
compris de lois en vigueur ou de projets de lois , d’actions et de politiques étatiques , et de responsables
étatiques ou de candidates à un emploi public . Les r estrictions sont souvent, mais pas toujo urs , impos ées afin
d’empêcher les OSC de faire de la propagande électorale , comme des campagnes et des collectes de fonds
pour des partis politi ques ou des candidats.
Les activités économiques peuvent être définies comme des transactions commerciales régul ières
comprenant la vente de biens et de services. Ici encore , nous trouvons une grande variété d’approches
réglementaires concernant le degré permissible d’activité économique . En général , les OSC ont le droit de
pratiquer la vente de biens et de services (en particulier ceux liés à la mission de l’ organi sation). L’impôt sur le
revenu des activités économiques est une question connexe mais distincte , et va au -delà la portée de ce guide .
Transparenc e et reddition de compte
La transparence et la reddition de compte des OSC devraient, idéalement, être un objectif partagé par le
go uvern ement et les OSC, les bailleurs de fonds et bénéficiaires des OSC . Comme avec la go uvernance interne
– qui est un point de départ fondamental pour avoir des OSC transparent es et responsables – la loi doit jouer
un rôle crucial afin de définir les normes de transparenc e et de reddition de compte . I l est important de
souligner à nouveau , néanmoins , que le droit international établit une présom ption contre tout règlement
48 See Guidelines for Laws Affecting Civic Organizations , © 2004 Open Society Institute, pages 53 -59. 49 Po ur plus d’informations sur le cadre juridique des organisations d’intérêt public, voir ICNL sur ce lien .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 26
étatique q ui constituerait une restriction des droits reconnus , y compris le droit à la liberté d’ association. Les
acteurs i nternationa ux soutenant les processus de réforme doivent contribuer à empêcher les efforts des
go uvern ement s visant à étouffer ce secteur par le biais de réglementations juridique es justifi ées par des
appels à la transparenc e et à la reddition de comptes .
Un outil de réglementation courant utilisé par les go uvern ements pour garantir la responsabilité est de
demander la présentation de rapp orts. La question de la demande de présentation de rapports est complexe ,
en particulier étant donné la gamme variée d’ organi sations au sein de la société civile . Beaucoup, sinon la
plupart des OSC , sont des organisations petites , basées sur les communautés, qu i ne sont pas toujours
enregistrées , qui souvent dépendent des services de bénévoles plutôt que d’employés rémunérés , et
reçoivent peu ou pas de financement public, que ce soit sous la forme d’e xemptions d’impôts ou de
subventions directes ou de dons ; en général ces OSC n’ont pas à soumettre de rapport au go uvern ement. Les
autres OSC sont des organi sations professionnelles avec des bureaux, des employés rémunérés et de gros
budgets. Elles doivent être enregistrées et peuvent bénéficier d’avantages fiscaux , sous la forme
d’exemptions d’impôts ou de subventions gouvernementales ; ces OSC doivent en général soumettre des
rapports financiers et d’activités de manière régulière . Le problème réglementaire avec ces obligations de
rapports est de développer et de m ettre en œuvre un système qui reconnaisse la diversité de la société civile
et impose des obligations de contrôle où ceci est nécessaire dans une société démocratique pour répondre à
un intérêt gouvernemental légitime . Les Guidelines for Laws Affecting Civ ic Organizations (Directives pour les
lois concernant les organisations civiles) de l’Open Society Institute fournissent des information s
supplémentaires sur la façon dont le cadre juridique peut aider à soutenir la transparenc e et la reddition de
comptes .50 Il faut également prendre note du débat actuel sur les questions plus larges de la
responsabilisation des ONG .51
Enfin, on peut noter qu’un cadre juridique habilitant peut et doit également permettre , et peut -être même
encourager , l’auto -réglementation v olontaire . Par le biais d’une auto -réglementation volontaire , les OSC
peuvent fixer et respecter des normes élevées de condu ite et de résultats . Les organisations repr ésent ant le
secteur dans son ensemble ou un sous -secteur (par ex. , les OSC s’occupant des droits de l’Enfant ) joueront
parfois un rôle de leader à cet égard . Une organisation individuelle peut choisir d’ adopt er son propre code de
conduite interne . Toute initiative d’auto -réglementation fructueuse devra considérer les incitations afin
d’adhérer à des normes de go uvernance plus rigoureuses que ce que la loi demande , et également réfléchir à
la question du contrôle et de l’application .52
D. Importance du cadre juridique et réglementaire pour la société c ivile
1) Cadres juridiques et de réglementat ion habilitants ou restrictifs
50 Voir Guidelines for Laws A ffecting Civic Organizations , © 2004 Open Society Institute, pages 65 -75. 51 Voir Jem Bendell, Debating NGO Accountability , © 2006 UN ; Kumi Naidoo, “Civil Society Accountability: Who Guards the Guardians? ©
2003 CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation; Gary Johns, NGO Way to Go: P olitical Accountability of Non -Governmental
Organizations in a Democratic Society , © 2000 Institute for Public Affairs (); Hugo Slim, By What Authority? The Legitimacy and
Accounta bility of Non -Governmental Organisations , © 2002, International Council on Human Rights Policy. 52 Pour une base de données et une carte interactive mondiale des initiatives d’auto -réglementation de la société civile, voir One World
Trust .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 27
L’impact précis du cadre juridique sur le d évelop pe ment de la société civile – et sur la santé , le dynamisme et la
durabilité du secteur civil – est peut -être difficile à mesurer .53 Il est clair que le cadre juridique est seu lement
un facteur parmi d’autres qui influence la portée et la force de la société civil e dans n’importe quel pays . Les
facteurs politiques, culturels , histori ques et économiques jouent également un rôle important .
Il est indiscutable cependant que l’ application de la loi a un impact direct sur la société civile. Le cadre juridique
et la façon dont il est appliqué affectent directement la capacité des OSC à se former, à fonctionne r et à être
autonome . Le secteur dans son ensemble a la capacité d’impliq uer les citoyens , de fournir des services,
d’échanger avec l’Etat , et de participer par ailleurs à la vie social e, politi que et économique . Ensemble, ces
activités contribuent à faire progresser le développement démocratique , la prestation de service s et a utres
objectifs au niveau macro .
On peut imaginer que la loi offr e un espace légal – de la même manière que qu’un bâtiment public fournit un
espace architectural – au sein duquel les i ndividus peuvent par le biais des OSC agir pour traiter une gamme
étendu e d’objectifs à bénéfices mutuels et d’intérêt public . Cet espace légal peut être ouvert, largement
accessible, favorable et habilitant , o u alors fermé , diffic ile d’accès , limitatif et inhibit eur . Le premier s’inscrit
dans le cadre juridique habilitant , et le dernier dans un cadre juridique restricti f.
Plus récemment , le droit a été utilisé comme l’outil choisi par les go uvern ements pour limiter l’espace
disponible pour la société c ivil e, afin de créer des obstacles à leurs activités et sources de financeme nt et de
menacer leur existence même . Par l’intermédiaire de ces fardeaux réglementaires , les go uvern ements ont
essayé d’affaiblir et de miner les sociétés civiles naissantes dans leurs pays respectifs . Les fardeaux
réglementaires peuvent adopter de nombre uses form es – obstacles à la création , à l’enregistrement ,
ingérence go uvern ement ale dans les affaires intern es des OSC , taxation excessive , obstacles aux
financem en ts étr angers , sanctions punitives et autres contraint es légales . Mais l’ impact négatif est évident et
on le voit avec la capacité réduite des OSC à particip er de manière efficace aux questions d’ importance
publique et leur lutte pour leur survie .
53 Des indices notables ont cherché à évaluer l’impact de la réforme légale et réglementaire. Ils compr ennent par ex. la Johns Hopkins
University (Centre d’Etudes sur la société civile) Comparative Nonprofit Sector Project , l’ Indice de la société civile CIVICUS et l’ Indice
de durabilité des ONG d’USAID .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 28
2) Le process us d’application
La force et la viabilité de la sociét é civile ne sont pas simplement des questions de cadre juridique , et le degré
selon lequel il est habilitant ou restricti f. C’est bien entendu également une question d’application . Une bonne
loi, bien rédigée risqué parfois d’être mal appliquée ou pas app liquée du tout . Bien sûr, les juges et les avocats
jouent un rôle clé dans l’application des lois .
Secteur de la société civile
Meilleure participation du public
Répondre aux besoins sociaux, y compris par la prestation de services
Donn e rune voix aux groupes vulnérables
Surveiller les résultats du gouvernement
Durabilité financière du secteur (pas nécessairement autonome)
Partenariat avec l’Etat et le monde des Affaires
Organisations individuelles de la société civile
Faciliter leur création en tant q u’entité organisationnelle
Normes de gouvernance interne
Capacité à s’impliquer dans une gamme étendue d’activités, y compris le
plaidoyer et la prestation de services, afin de remplir sa mission
Capacité à chercher et à obtenir des ressources par le biais d’une activité
économique, de dons privés et de financement étatique
Capacité à participer à la prise de décision.
Soutenir le
dé velop pe ment social et
économique
Mesure de l’environnement juridique pour les OSC
Des indices notables ont cherché à évaluer l’impact de la réforme juridique et
réglementaire sur la société civile. On trouve parmi d’au tres :
The Comparative Nonprofit Sector Project , Johns Hopkins University
Civil Society Index (Indice de la société civile) , CIVICUS
NGO Sustainability Index (Indice de durabilité des ONG) , U.S. Agency for
Internation al Development
Soutenir le d évelop pe ment
démocratique
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 29
En même temps , néanmoins , une législation de mauvaise qualité, mal adaptée et même contraignante risqu e
d’être progressivement appliquée .
Pour résum er, la question de l ’application – et le degré selon lequel une loi est appliquée de manière juste,
objective et apolitique – est aussi important e que le cadre juridique lui -même et la qualité de sa présentation
sur le papier .
Application progressive
Hongrie : Le cadre juridique en Hongrie ne prévoit pas l’enregistrement d’un bureau régional d’une OSC étran gère ; il s’agit
simplement d’une lacune dans la loi. Pour répondre à cette situation, le gouvernement hongrois a fac ilité le travail des OSC
étrangères en Hongrie en leur permettant de s’enregistrer comme agence à but non lucratif d’une société commercial e.
L’obstacle juridique a donc disparu par le biais d’une approche pratique du problème.
Liban : Le cadre juridique affectant les OSC au Liban est base s ur une loi sur les associations de 1909 à l’époque ottomane. Il
n’est pas étonnant de voir que la loi définit des procédures d’enregistrement obsolètes, demandant a ux associations d’écrire
à l’Autorité impériale ottomane, de régler les frais d’enregistreme nt dans la monnaie de l’époque ottomane, etc. Le
ministère de l’Intérieur libanais a diffuse des directives afin « d’interpréter » la loi ; à travers la majorité de l’histoire moderne
du Liban, les directives interprétaient la loi de manière régressive, co mpliquant les choses pour les OSC. Plus récemment, le
nouveau ministre de l’Intérieur Dr Ahmad Fatfat a diffusé des directives plus progressistes, demanda nt seulement une
notification plutôt qu’une demande d’approbation lors de la phase d’enregistrement.
Ukraine : La loi sur les Associations publiques interdit aux associations de se lancer dans des activités écon omiques et limite
les activités selon le statut territorial des associations. Aucune des clauses n’est à l’heure actu elle appliquée par le
gouvern ement.
Problème d ’application
Bosnie -Herzégovine : La loi de 2001 sur les Associations et les Fondations en Bosnie -Herzégovine est considérée
comme un exemple de législation bien rédigé e, habilitante , qui présente un processus d’enre gistrement clair,
simple et direct au niveau de l’Etat . [Voir note] L ’application au niveau de l’Etat, cependant, a régulièrement
été un problème, dans le sens où les responsables de l’enregistrement ont souvent refusé une inscription aux
demandeurs (comm e à des syndicats ou des associations en tant que personnes morales ), alors même qu’ils
étaient dans leurs droits selon la loi .
Territoires palestiniens : La loi N°1 de 2000, la loi sur les Associations carit atives et Organi sations
communautaires , est en g énéral considérée comme l’une des meilleures lois sur les OSC dans le monde arabe .
Elle définit une proc édure d’enregistrement et un mécanisme de contr ôle relativement libéra ux .
Malheureusement, néanmoins, les circonstances politiques ont empêché son appli cation efficace, et à l’h eure
actu elle, le gouvernement dirigé par le Hamas est opposé à la cette loi et a choisi soit de l’ignorer soit de la
circonvenir de manière active .
Afrique du Sud : Conçue pour créer un environnement habilitant et encourager la bo nne gouvernance pour le
secteur civi l, la Loi de 1997 sur les organisations à but non lucratif (NPO) fournit à certaines cat égories de NPO
des avantages en matière d’impôts et de fiscalité . Etant donné l’immense retard dans les demandes
d’enregistrement et les problèmes de gestion, de nombreuses NPO n’ont pas d emandé d’enregistr em ent dans
le cadre de la loi et par conséquent ne peuvent pas bénéficier des avantages fiscaux .
Note : Etant donné la structure constitutionnelle de l’Etat bosniaque, il existe troi s (3) lois sur les associations et
fondations, une applicable à la Républi que de Srpska, une à la Fédération de Bosni e- Herz égovin e et la dernière applicable
à l’Etat de Bosni e. Nous faisons ici référence çà cette dernière .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 30
III. Vue d’ensemble de l’env ironnement juridique dans certains pays
Cette partie présente quatre (4) études de cas, ou plus précisément, quatre études de pays, qui ana lysent
brièvement les cadres juridiques gouvernant les OSC dans chacun de ces pays, qui soulignent les obstacles
ma jeurs à la réforme juridique et qui décrivent les stratégies adoptées pour surmonter ces obstacles.
Les pays sélectionnés – Afghanistan, Libéria, Mauri ce et Serbie – représentent un champ géographique étendu
et une gamme diversifiée de difficultés en mati ère de réforme juridique . Pays en situation de post -conflit,
l’Afghanistan offre un aperçu des énormes pressions qui peuvent peser sur le processus de réforme juridique ,
où les OSC sont considérées comme des gr os consommateurs d’aide étrangère. Le Libéria fait face à des
problèmes similaires. En tant que pays à revenu moyen et avec une population de 1,2 millions d’habit ants,
Mauri ce possède une société civile relativement bien développée, qui est soutenu par un cadre juridique assez
progressiste. Or, des ch angements économiques sont en train de créer de nouvelles tensions au sein de la
société et le besoin d’améliorer la capacité des OSC est de plus en plus marqué. Dans sa transition d’un régime
autoritaire à une jeune démocratie, les tentatives de réforme juridique en Serbie ont été, jusqu’à une époque
très récente, frustrée par les disputes politiques de l’élite. En examinant de près chaque pays, nou s espérons
tirer des leçons globales.
A. Afghanistan
1) Obstacles à la réforme juridique
Dans les années qui ont suivi la chute des Talibans (de 2001 à 2005), il y avait deux possibilités statutaires pour
les groupes civiques cherchant à se faire reconnaître de façon légale : une organisation sociale et une
organisation non -gouvernementale (« ONG »). La plupart des o rganisations, y compris les organisations
étrangères, était déclarée en tant qu’ONG et gouvernée par des mesures datant de l’époque des Taliba ns – le
Règlement sur les activités des organisations non -gouvernementales locales et étrangères en Afghanistan. 54 En
effet, jusqu’au mois de juin 2005, il y avait plus de 2300 « ONG » et autour de 400 organismes sociaux déclarés.
Par conséquent, les premières initiatives de réforme se consacrèrent au Règlement taliban sur les ON G et
cherchèrent à améliorer le cadre juridique des ONG en particulier.
Malheureusement, les ONG se sont retrouvées dans un environnement opérationnel de plus en plus marqu é
par la suspicion, la méfiance et même l’hostilité envers elles et le secteur associatif en général. Au sein du
gouverneme nt, et de la population plus globalement, beaucoup de personnes croyaient que les ONG
participaient à des activités lucratives, en détournant l’aide monétaire étrangère. Les ONG étaient devenues
les boucs émissaires pour tout ce qu’on percevait comme étant des abus.
Des véritables cas de comportement abusif avaient sans doute ajouté foi aux perceptions négatives.
Toutefois, il est pratiquement certain que ces perceptions négatives étaient basées, au moins en par tie, sur un
manque de compréhension relatif à la définition des ONG, ce qu’elles font et comment elles travaillent.
Vraisemblablement, la perception négative provenait du fait que les donateurs préféraient répondre a ux
besoins de reconstruction en passant par les ONG, plutôt qu’en traitant directemen t avec le jeune
gouvernement afghan. Cependant, ce qui paraît tout aussi plausible, c’est que le cadre juridique insuffisant
des ONG, vestiges de l’époque des Talibans, a laissé travailler les ONG dans un espace juridique ambigu et
incertain, pendant trop longtemps, nourrissant ainsi une atmosphère pleine de doute et de méfiance.
54 Le Règlement des Talibans fut proclamé en 2000, dans la Gazette officielle, No. 792.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 31
Parmi les problèmes spécifiques :
Les ONG étaient mal définies, créant ainsi une confusion sur l’objet de la règlementation.
Les critères d’éligibilité étaient assez vagues et s ujets à la discrétion administrative arbitraire ; il n’y
avait pas de délai établi pour les décisions définitives ni la possibilité de faire réexaminer les d écisions
par l’administration ou par la justice.
Les règles de g estion interne n’étaient pas pres crites, même pas en titre, et il n’y avait aucune
obligation de responsabilité financière, ce qui sapait la confiance du public dans la transparence e t la
crédibilité des ONG.
Les règles de signalement et de responsabilité publique étaient draconiennes da ns la forme, mais très
peu appliquées, créant ainsi de l’incertitude, ainsi qu’un potentiel d’actions arbitraires de la par t des
autorités, et des fraudes dans le secteur.
Leçons apprises : Afghanistan
L’importance de la volonté politique .
Le processus de rédaction des lois en Afghanistan a été initié avec le soutien du Ministère de la Planification
(qui était à l’époque responsable de la déclaration et la surveill ance des ONG). Sous sa direction, un groupe
de travail trans -sectoriel a été créé. Ce processus – qui a donné lieu à un projet de loi d’habilitation – a été
bloqué après un changement de direction au Ministère et la désignation d’un nouveau ministre qui était
non seulement contre la promulgation de la loi d’habilitation, mais qui a d’ailleurs proposé une loi
régressive (contre laquelle les OSC présentes en Afghanistan ont vivement protesté). Ce n’est qu’apr ès la
démission du ministre (décembre 2004) que l e processus de réforme législative a pu être relancé.
L’importance des gro up es de travail tran s-sectoriels .
En 2002/2003, le processus de rédactio n législative s’est basé, dès le début, sur un groupe de travail
comprenant des représentants de la société civile et du gouvernement. Cela a abouti à un projet de loi
offrant plus de possibilités que celui qui a suivi en 2005, quand le gouvernement s’est occupé de la
rédaction, en sollicitant des commentaires externes seulement vers la fin du processus. L’impl ication des
OSC dès le départ augmente les chances de faire correspondre la législation aux besoins des deux sec teurs.
L’importance d’un e plus grande participation du public .
En 2003 et en 2005 , il y a eu des tentative s de solliciter des réactions et la participation de toute la
communauté des OSC. En 2003, cela a rendu les projets de loi plus légitimes. En 2005, si cela a perm is aux
OSC d’exprimer leurs préoccupations, ce n’était pas suffisant pour compenser leur absence pendant le
processus de rédaction lui-même, ou pour rendre le projet de loi légitime.
L’importance du soutien des donateurs .
Les donateurs risquent d’avoir plus d’influence sur le gouvernement que les OSC eux -mêmes. Cette
influence, si elle est bien utilisée, peut servir à créer un im pact positif. En 2005, la mesure excluant les ONG
des appels d’offre gouvernementaux a attiré l’attention des donateurs sur le projet de loi. C’est la
contestation vive de ces derniers, y compris celle de l’UNAMA, qui a entrainé la mise en place d’une « force
d’intervention conjointe » chargée de faire des recommandations relatives à cette mesure et au projet de
loi en général. Suite aux recommandation s des donateurs , l’exclusion des appels d’offre a été révoquée.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 32
2) Stratégie de la réforme juridique
Le gouvernement a reconnu l’importance de d évelopper un cadre juridique détaillé pour les ONG présentes en
Afghanistan pendant la période initiale de reconstruction. Avec l’appui du ministère d u Plan, un groupe de
rédaction juridique a été crée, comprenant des représentants de certains ministères c lés et ceux du secteur
des ONG. Ce groupe a préparé un projet de loi progressiste sur les ONG, qui a été distribué à un max imum
d’ONG partout dans le pays. Sur la base de leurs réactions, le projet de loi a été révisé et affiné, avant d’être
soumis au mini stère d u Plan en juillet 2003. Le projet de loi du juillet 2003 était ainsi le résultat d’un processus
largement inclusif et profondément participatif, qui impliquait et les ONG et les autorités gouverne mentales.
Malheureusement, après des changements de p ersonnel au ministère ainsi que d’autres contretemps, la
réforme n’a pas avancé et le projet de loi n’a pas été promulgué.
Par la suite, en janvier 2005, le nouveau gouvernement afghan, fraîchement élu, a fait de la promulgation
d’une nouvelle loi sur les ONG l’une de ses priorités. Le ministère de l’Économie a sorti un nouveau projet de
loi en février 2005. Ce projet de loi se basait, en partie, sur celui de 2003, mais il comportait ég alement des
différences considérables, visant à contrôler voire réprime r l’activité des ONG. Après des protestations venant
du secteur des ONG et de la communauté internationale, le gouvernement a décidé d’affiner le projet de loi,
en sollicitant des contributions des ONG et des donateurs étrangers. C’est ainsi que le projet de loi a subi une
série de modifications entre février et juin 2005.
Le Président Karzai a signé la nouvelle loi sur les ONG en juin 2005. À la différence du Règlement d es Talibans,
la nouvelle loi respectait les normes internationales et les bonnes prati ques règlementaires, dans de
nombreux domaines fondamentaux. Cela dit, certaines mesures de la loi, et s on application posent encore
problème.
B. Libéria
1) Les obstacles à la réforme juridique
Pendant deux décennies d’agitation et de guerre civile (1989 -20 03) au Libéria, les organisations de la société
civile sont intervenues pour fournir des services de base et de l’aide à la population, après l’éche c des
structures et des systèmes gouvernementaux. Les OSC étaient aussi au centre du mouvement en faveur d e la
démocratie et ont œuvré pour la garantie des droits fondamentaux de l’homme. Leur rôle accru dans la
prestation de services et dans l’aide humanitaire a entraîné la prolifération des organismes – à un moment
donné il y avait plus de 1000 ONG travaillant au Libéria, pour une population qui dépasse légèrement les 3
millions. Le manque de directives précises et de coordination entre les différents ministères respon sables et la
négligence du secteur ont créé de la confusion et des abus. Par ailleurs, l’absen ce d’obligations pour les ONG,
envers leurs bénéficiaires, a fini par susciter des doutes sur la nature et la durabilité de leur tr avail.
Les défis comprenaient :
Le manque de directives précises pour les ONG sur la manière de se déclarer et de se fair e accréditées,
donnant lieu à une prolifération d’ONG, y compris les soi -disant « ONG fictives ou bidon », qui n’existent
que sur papier.
L’absence de mécanismes centralisés pour rendre des comptes, donnant lieu à une multiplication des
demandes, émanan t des différentes institutions gouvernementales, pour les divers rapports des ONG.
La demande croissante, venant du secteur des ONG, d’une clarification des procédures relatives à leu r
fonctionnement quotidien : par exemple pour le personnel, l’immigrati on, la taxation, les exemptions
des droits de douane et des questions de logistique, comme le stockage ou le transport.
Le besoin d’améliorer la transparence et la responsabilité au sein des ONG.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 33
La nécessité de développer un mécanisme efficace de coopéra tion entre les ONG et le gouvernement
du Libéria (GoL) pour favoriser l’engagement civique dans la définition d’un agenda de
développement national et dans le processus de réforme.
2) Stratégie de réforme juridique
Dans les années 1980, il y a eu des tentat ives d ’application des directives pour encadrer les Organisations
volontaires privées (OVP). Si ces directives ont été votées en 1988, elles étaient en grande partie non
applicables à cause de la guerre civile. D’autres tentatives ont eu lieu en 2000, 2001 et 2005 pour élaborer une
Leçons apprises : Libéria
L’importance d’ identifier et de travailler avec les meilleurs éléments du gouvernement :
Le développement de cette politique a pu bénéficier de la bonne volonté du G oL, qui l’a classé en tant que
priorité dans la SPRD. Au -delà de cette volonté politique, le processus a aussi eu l’appui de certaines
personnes clés du Ministère de la Planification et de l’ Économie (MPE A). Le Ministre et son adjoint ont bien
compris l’importance de collaborer avec la société civile pour élaborer une politique juste , qui pourrait
encadrer le travail des ONG, renforcer le rôle de surveillance joué par le gouvernement, tout en laiss ant un
esp ace d’autorégulation aux ONG . Ces points d’appui ont pu prendre en compte les préoccupations et les
points de vue divergents au sein du ministère, et dans d’autres ministères clés, pour trouver un consensus
gouvernemental sur les dispositions de la politique.
L’importance de trouver un terrain d’entente à partir d’ un échantillon des organisations de la société civile :
Les ONG internationales voulaient à tou t prix que la politique aborde les procédures opérationnelles
standards – la déclaration, la taxation et l’exemption des droits de douane – tandis que les organisations de
la société civile se focalisaient sur la démocratie naissante du pays, ne considéran t ce processus politique que
comme un pas vers cette démocratie. Ils voulaient être sûrs qu’au lieu de régler les activités des p etites ONG
de façon rigide, la politique allait plutôt garantir leur participation et leur engagement dans la d éfinition d’un
agenda national. Il fallait absolument trouver un terrain d’entente au sein du secteur pour renforcer le
dialogue avec le gouvernement. L’autoréglementation a donc été proposée comme alternative à la
réglementation gouvernementale. On a suggéré que la parti cipation au Conseil national des ONG
(l’organisme qui serait chargé de l’autoréglementation et de la coordination) soit volontaire, puisq ue
beaucoup d’ONG internationales n’étaient pas sûres de participer aux mécanismes nationaux
d’autoréglementation. La p olitique a encouragé tous les ONG accréditées à devenir membres du Conseil des
ONG.
L’importance d’aborder les pr éoccupations principales des partenaires :
Une leçon clé, c’est l’importance d’aborder les préoccupations sous -jacentes des diff érent s parten aires, afin
de garantir leur engagement pérenne au processus d’élaboration politique, et pour réussir la mise en œuvre
de la politique elle -même. Il était devenu nécessaire d’examiner les questions de transparence et de
responsabilité dans les ONG. Ces der niers, avec l’ONU ont réussi à renforcer la capacité d’autorégulation des
ONG, et ainsi éviter l’amplification du rôle de surveillance joué par le gouvernement, qui nécessite rait
l’allocation de ressources et de capacités précieuses, pour le contrôle des p rojets et des activités financières
des ONG.
L’importance d’un soutien constant pour la mise en œuvre de la politique sur les ONG :
Le soutien à la législation sur les ONG devrait s’ élargir à sa mise en œuvre, pour assurer qu’elle soit la plus
efficace p ossible.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 34
politique sur les ONG. Une version préliminaire a été avancée en 2005 lors du mandat du gouvernemen t de
transition, mais elle n’a jamais été adoptée.
En 2005, le PNUD a soutenu un projet pour cartographier les organisations de la société civile. Le rapport
définitif de ce projet a souligné la nécessité d’impliquer le PNUD dans le développement d’un cadre politique,
pour assurer un espace juridique et garantir les conditions de travail des OSC et des ONG en particulier.
Le premie r gouvernement d’après -guerre, démocratiquement élu en 2006, a reconnu le rôle indispensable
joué par les OSC et, en particulier par les ONG, en fournissant des services basiques et de l’aide h umanitaire. Il
a également reconnu l’importance permanente de c es dernières dans l’avancement de l’agenda national de
développement. En réponse à la demande exprimée par les ONG et par le public en général, le gouverne ment
a donc rendu prioritaire l’élaboration d’une politique sur les ONG et de directives pour encadre r le travail des
ONG au Libéria. Cela a été reflété dans la Stratégie provisoire de réduction de la pauvreté (SPRP) d e 2006.
La Constitution du Libéria, adoptée en 1986, garantit le droit d’association, aussi, le cadre politi que avait
comme objectif de do nner des directives claires en matière de déclaration ( enregistrement ) et de
surveillances des activités des ONG. Le Ministère de la Planification et de l’Économie (MPE) a reçu le mandat
de surveiller et d’évaluer les activités des ONG, et d’améliorer la coopération entre le GdL et les ONG. Il a
demandé l’aide du PNUD pour élaborer cette politique.
Ce dernier à répondu à la demande du MPEA et, en 2007, un consultant a été embauché pour préparer un
projet de cadre politique, après de nombreuses réunions a vec des ONG locales, nationales et internationales,
des agences gouvernementales, des donateurs et le système de l’ONU. Le MPEA a en même temps élaboré
une autre version préliminaire de la politique, dont les mesures limitaient considérablement l’indép enda nce
des ONG. Ces prévisions comprenaient, entre autres, la remise de toutes les propositions de projet a u MPEA
pour son accord, avant même de chercher des financements et la surveillance ponctuelle des activités des
ONG par les autorités locales.
Cette ve rsion préliminaire du ministère a déclenché un tumulte de protestations et a été sévèrement critiqué e
par les ONG nationales et internationales. Les Nations Unies ont aussi envoyé leurs commentaires au
ministère, en le conseillant vivement de développer de s directives qui limiteraient et le travail des ONG et la
capacité et les ressources du ministère. Le PNUD et la MINUL on joué un rôle essentiel en facilitant le dialogue
entre, d’un côté, les ONG nationales et internationales et, de l’autre, les ministère s concernés. Un comité de
travail, présidé par les MPE, a été mis en place, avec des représentants du Comité de Conseil de la Société
civile (un regroupement de 15 organisations principales nationales), du Groupe de Direction et de Pilotage (un
regroupemen t des ONG internationales présentes au Libéria) et des différents ministères impliqués. Le PNUD
et la MINUL ont également participé à ce comité de travail, et le PNUD a fourni un soutien logistiqu e pour ces
réunions. Les membres du comité ont négocié chaq ue aspect, afin de proposer une nouvelle politique sur les
ONG en juillet 2007. Avec l’appui du PNUD, le Comité de Conseil a organisé toute une série d’atelier s de
proximité, pour présenter cette politique aux OSC dans d’autres régions du Libéria et, ainsi , impliquer dans ce
processus celles qui étaient en dehors de la capitale. En janvier 2008, la version définitive a été validée lors
d’une réunion des partenaires nationaux. En juin 2008, avec l’accord du conseil des ministres, la Politique
nationale sur l es Organisations Non Gouvernementales a été mise en vigueur
Le PNUD continue à offrir une assistance technique et logistique aux ONG nationales et au MPEA, afin de
rendre plus efficace la mise en œuvre de la politique. Il a soutenu la signature d’une lett re d’intention entre 22
ONG locales clés et les réseaux d’ONG, pour lancer e processus de concertation, relatif à la créatio n d’un
Conseil d’ONG, un organisme d’autorégulation et de coordination des ONG. Une fois établi, ce Conseil
représentera les intérêt s des ONG dans tout type de collaboration avec le gouvernement et dans les processus
de dialogue national. Le PNUD soutient également la Commission de Gouvernance, pour consolider la
politique nationale, afin de développer une stratégie claire pour l’insti tutionnalisation de l’engagement civique
dans les processus de gouvernance et de développement, aux niveaux locaux et nationaux.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 35
C. Mauri ce
1) Obstacles à la réforme juridique
Depuis son indépendance en 1968, Mauri ce est passé d’une économie agricole à fa ibles revenus, à une
économie diversifiée à revenus moyens, avec des secteurs industriels, financiers et touristiques cro issants. La
transition économique a sans doute rajouté de nouvelles tensions sociales, poussant le gouvernement à
dépendre plus de la s ociété civile pour satisfaire aux besoins de la population.
Le cadre juridique concernant la société civile à Mauri ce prend racine dans le droit coutumier, le droit civil et
dans les traditions juridiques musulmanes. Cette nature hybride se manifeste par la gamme de formes
organisationnelles disponible pour les OSC – les associations, les organisations et clubs de jeunesse, les clubs
et fédérations sportifs, les organisations multisports, les caisses de retraite, les sociétés à but non lucratif, les
fondat ions (y compris les fondations caritatives et les « waqfs »- donations à perpétuité dans le monde
musulman – parmi d’autres).
La grande majorité des OSC à Mauri ce sont créées et déclarées en tant qu’associations – près de 8000
organisations figurent sur le s registres officiels, même si les estimations du nombre d’associations actives à
tendance à varier.
Si la loi régissant les associations établit un cadre juridique viable, il reste du travail à faire dans plusieurs
domaines stratégiques. Quelques exempl es :
La loi ne prévoit pas suffisamment de sauvegardes procédurales pour assurer un processus rapide de
déclaration.
La loi n’aborde pas convenablement les questions de transparence, de bonne gouvernance et de
responsabilité.
De façon louable, le cadre fiscal prévoit un statut caritatif, qui donne lieu à des exonérations fiscales,
mais les procédures de mise en œuvre sont assez vagues et il n’existe pas de normes pour rendre des
comptes.
Les incitations fiscales pour les donateurs individuels ont été supprimées en 2006, et ceux applicables
aux sociétés en 2007, ont réduit la capacité des OSC d’attirer des financements.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 36
2) Stratégie de la réforme juridique
Étant donné l’importance du cadre juridique , par rapport à la capacité, la force et la via bilité de la société civile,
et compte tenu de l’importance d’avoir un secteur civique fort et capable par rapport au développem ent
économique et social de Mauri ce , les bureaux locaux du PNUD ont conçu et préparé un projet exhaustif de
soutien à la sociét é civile, intitulé Renforcer le Secteur des ONG à Mauri ce . Ce projet de trois ans (2005 -2007) a
été financé et administré par le PNUD. Sa mise en œuvre a été réalisée en partenariat avec le Consei l mauricien
des Services Sociaux (MACOSS), le ministère de l a Couverture sociale, la Solidarité nationale, l’Assistance
sociale des seniors et les institutions de réhabilitation ( ministère de la Sécurité Sociale). En renforçant le
secteur des ONG, le projet vise à améliorer son rôle en tant que partenaire compétent et sérieux du
gouvernement et du secteur privé, dans le développement socioéconomique du pays.
Leçons apprises : Mauri ce
L’importance d’une stratégie exhaust ive .
Le processus de réforme juridique n’est pas isolé, mais fait partie d’un projet général de
renforcement de la société civile, comprenant plusieurs cycles, qui examinent la polit ique
gouvernementale relative la société civile, la responsabilité sociale des entreprises et l’état de la
société civile de manière globale, à travers des études empiriques. Les résultats de ces études, ave c
d’autres, ont créé une base de recherche pour l a révision des lois. Après des longues phases de
recherche, de consultation et de recommandations écrites, la nouvelle phase pratique de mise en
œuvre démontre à quel point le processus de révision a été bien planifié et réalisé.
L’importance du temps .
Le processus de réforme juridique à Mauri ce se distingue non seulement parce qu’il fait partie d’une
stratégie exhaust ive, mais aussi parce que les décideurs ont reconnu que ce processus nécessite du
temps. L’évaluation du cadre actuel et des besoins de réf orme législative a été faite après une phase
initiale de 9 mois, comprenant des multiples entretiens et réunions de réflexion, et après un examen
complet des lois et des règlements. Compte tenu des besoins en matière de temps, la rédaction et la
révision d u projet de loi ont été échelonnées, de manière à garantir la plus grande légitimité.
L’importance de la participation du plus grand nombre .
Les conclusions de cette révision juridique se basent sur un processus approfondi de collecte de
données, grâce à une série d’entretiens et de réunions de réflexion avec les autorités
gouvernementales et les représentants des OSC. Par ailleurs, la présentation des conclusions et des
recommandations préliminaires lors d’un atelier national, a facilité encore plus l’eng agement public
dans le processus et a contribué à l’affinement de la révision juridique. En plus, le soutien et la
participation dans le processus ont été pérennisés par des activités pratiques de sensibilisation.
L’importance de l’assistance technique .
Mauri ce possède un système juridique bien développé, enraciné à la fois dans le code civil français
et dans le droit coutumier britannique. Le consultant juridique national chargé de préparer la
révision des lois est un avocat expérimenté en exercice, pr ofesseur de droit et Président de la
Commission pour la Réforme juridique . Toutefois, l’introduction de l’expérience comparative
internationale s’est avérée indispensable, pour donner une plus grande perspective aux forces et
faiblesses du cadre juridique mauricien, concernant la société civile .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 37
La révision du cadre juridique et règlementaire concernant la société civile n’était qu’un composant du projet
global, les autres étant une évaluation partici pative de la société civile au moyen de l’Indice de la Société Civile,
un bilan complet du Conseil mauricien des Services Sociaux (MACOSS), un examen des politiques gouvernant
la responsabilité sociale des entreprises mauriciennes et une révision de la pol itique gouvernementale relative
à la société civile. Les résultats de chacun des ses composants ont contribué à la révision des lois .
L’évaluation juridique a étudié le cadre juridique et règlementaire ayant un impact sur tous les aspects du cycle
de vie d es ONG, c’est -à-dire, leur définition, leur existence, leur gouvernance interne, la surveillance externe,
leur dissolution, leur financement et leur traitement fiscal. Cette évaluation a été entreprise par un Consultant
juridique national et par un Consult ant juridique international. Les deux avocats ont travaillé ensemble pour
rassembler et analyser des données d’aux moins trois sources :
1) Des études sur documents des lois, des règlements, des directives administratives et des décisions d e
justice ayant un impact sur les ONG.
2) Des recherches sur le terrain, réalisées en consultation avec les partenaires pertinents, pour améli orer
l’évaluation des pratiques de mise en œuvre elles -mêmes.
3) Un atelier national organisé par les partenaires du projet (PNUD, MACOSS et le Ministère de la Sécurité
Sociale), pendant lequel les conclusions et recommandations préliminaires ont été présentées pour
discussion.
Par la suite, un rapport préliminaire d’évaluation juridique a été préparé et distribué aux partenai res et à la
soc iété civile en général. Ce rapport a abordé des questions assez diverses, allant de la liberté d’ass ociation,
telle qu’elle est garantie par le droit international et par la Constitution de Mauri ce , à une vue d’ensemble du
cadre juridique régissant les dif férentes formes juridiques d’OSC, de la capacité des OSC de s’engager dans des
activités politiques publiques aux activités économiques, de la règlementation du statut caritatif e t le
traitement fiscal au cadre des différents types de financement direct. E n conclusion, ce rapport a fait des
recommandations spécifiques visant à améliorer le cadre juridique et réglementaire. Les rédacteurs ont
explicitement demandé des réactions concernant les conclusions et les recommandations contenues dans la
version préli minaire du rapport, qui a été finalisé en mai 2008.
Les résultats de l’évaluation juridique du projet Renforcer le Secteur des ONG à Mauri ce ont été développés
davantage et intégrés dans le prochain cycle d’activité du PNUD à Mauri ce – le Soutien au Dévelo ppement
Inclusif (SID). Les recommandations de l’évaluation juridique ont été prises en compte dans un proje t de loi,
qui, jusqu’en mai 2009, était encore à l’étude au niveau ministériel. En attendant l’arrivée du proj et de loi au
niveau du conseil des min istres, le SID a l’intention d’organiser de nombreux ateliers et des activités de
sensibilisation, afin d’améliorer l’impact de cette évaluation juridique.
D. Serbie
1) Obstacles à la réforme juridique
Jusqu’au mois de juillet 2009, les OSC présentes en S erbie travaillaient sous des lois archaïques, datant de
l’époque de la République fédérale socialiste de Yougoslavie (RFSY). Parmi ces lois figuraient les s uivantes :
1) La Loi sur l’association et sur les citoyens membres d’associations et sur les organisati ons sociales et
politiques établies sur le territoire de la RFSY (1990) ;
2) La Loi sur les organisations sociales et sur l’association des citoyens de la République socialiste de
Serbie (1982) ; et
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 38
3) La Loi sur les legs, les fondations et les fonds de la Répu blique de Serbie (1989).
Ces lois n’étaient pas en mesure d’offrir un cadre clair, exhaustif et habilitant aux OSC présentes en Serbie.
Parmi les faiblesses du cadre juridique figuraient :
Des critères obligatoires de déclaration pour les associations et les fondations ;
L’interdiction pour les personnes physiques ou morales étrangères de créer une association;
L’interdiction pour les OSC étrangères d’ouvrir des bureaux en Serbie ;
Le pouvoir discrétionnaire large des autorités chargées de la déclaratio n (y compris un critère selon
lequel les autorités déterminaient la nécessité de créer une fondation) ;
Le besoin de déclarer les membres des organisations internationales ;
La notion de bénéfice publique est rigoureusement définie selon la loi, excluant de nombreuses
activités traditionnellement considérées comme étant bénéfiques pour le public.
2) Stratégie de la réforme juridique
Depuis l’évincement de Slobodan Milosevic de la Serbie en 2000, il y a eu plusieurs initiatives pour moderniser
le cadre juri dique du pays. Ce n’est que le 8 juillet 2009, qu’une nouvelle loi sur les associations a été
promulguée. Avant cette date, la Serbie était l’un des rares pays européens dont le cadre juridique des ONG
n’avait pas encore subi une réforme, pour le mettre en conformité avec les normes internationales et les
bonnes pratiques régionales.
Toutefois, des progrès considérables ont été réalisés par la société civile serbe, avec l’appui des acteurs
internationaux, et l’expérience accumulée pendant ce processus servi ra à surmonter les obstacles à venir. À ce
jour, la plupart des initiatives de réforme juridique mettaient l’accent sur la révision du cadre juridique des
associations. 55 En 2001, un projet de loi sur les associations a été préparé, pour être affiné en 2002 , grâce en
partie à l’apport indispensable du Conseil de l’Europe et des ONG internationales et serbes. Ce proj et de loi est
resté en l’état, entre les mains du parlement serbe, avant d’être retiré à la suite des élections pr écipitées.
55 En plus, les initiatives de réforme législative, dans le passé ou le présent, comprennent l’élaborat ion d’un projet de loi s ur les ONG
étrangères, un autre sur les dotations et les fondations, et un troisième sur le volontariat. Les d eux derniers sont toujour s en cours
d’étude.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 39
En nove mbre 2004, le ministère serbe de l’Administration et des Collectivités locales a redémarré le processus
de réforme en diffusant un nouveau projet de loi sur les associations. Dès le début, le ministère a revendiqué
l’inclusion et la participation des ONG. Il a d’abord organisé une table ronde sur le nouveau projet de loi et
soutenu la mise en place d’un groupe de travail constitué d’ONG locaux et d’un expert international. En avril
2005, le ministère a diffusé un projet de loi révisé, en demandant les comme ntaires du groupe de travail des
ONG. Un mois plus tard, il a émis une troisième version de ce projet de loi, qui tenait largement c ompte des
commentaires du groupe de travail. En novembre de cette même année, en partenariat avec le Conseil d e
l’Europe et l’OSCE, le ministère a organisé une table ronde sur ce projet de loi, pour en discuter et pour parle r
des commentaires envoyés par le Conseil. En plus des représentants des instances organisatrices, de s
délégués des principales ONG présentes en Serbie, d es universitaires et des avocats des droits de l’homme ont
participé à cette table ronde.
En mars 2006, le ministère a convoqué une réunion du groupe de travail, pour présenter la version ré visée du
projet de loi, qui, par la suite, a été approuvé par le gouvernement et soumis au parlement. Entre temps, le
gouvernement a perdu sa majorité parlementaire, ce qui a donné lieu à des élections législatives en janvier
2007. Après la formation d’un nouveau gouvernement au printemps 2007, le projet de loi sur les associations a
été relancé en tant qu’initiative prioritaire, avec des petites modifications par le ministère, et i l a reçu
l’approbation du gouvernement. Il a failli être approuvé par l’assemblée nationale en décembre 2008, mais il a
été mis en attente p our des raisons procédurales. Compte tenu des amendements des règles et procédures de
l’assemblée nationale serbe, la Loi sur les associations a finalement été promulguée le 8 juillet 20 09.
Leçons apprises : Serbie
L’importance de la volonté politique.
En Serbie, le manque de volonté politique a limité la capacité des réformateurs locaux déterminés, d e
réaliser la réforme souhaité e. Il faut noter que les chefs gouvernementaux, tout comme les représentants
des OSC, ont reconnu le besoin de réformer, et ils ont travaillé en collaboration pour préparer le t errain.
Ainsi, dès que l’occasion s’est présentée, le projet de loi a été promulgué.
L’importance d es group es de travail tran s-sectoriels .
Comme c’était le cas en Afghanistan, nous avons trouvé qu’en Serbie, la mise en place de groupes de
travail trans -sectoriels, dès le début du processus, a été un élément clé pour la préparation d’un projet de
loi d ’habilitation sur les associations.
L’importance des contributions venant du grand public .
Encore une fois, on a fait des efforts pour solliciter des réactions et des contributions relatives au projet
de loi, en faisant circuler la version préliminaire à un maximum d’associations sur tout le territoire serbe.
L’importance d’impliquer les institutions multilatérales .
Le Conseil de l’Europe et l’Organisation pour la sécurité et la coop ération en Europe (OSCE) ont joué des
rôles majeurs dans le processus de r édaction l égislative, en convoquant les partenaires et en
commentant directement le projet de loi. En tant que membre du Conseil de l’Europe et candidat à
l’Union européen, la Serbie reste en général attentive à la position du Conseil.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 40
IV. Rôle des acteurs internationaux dans le développement d’un environnement civi l
favorable
Cette partie cherche à décrire les conditions préalables au succès des actions de réforme juridique , ainsi que le
rôle que les acteurs internationaux – ceux impliqués dans la conception et le développement de toute
initiative concernant la société civile – peuvent jouer, en œuvrant de manière efficace pour la promotion
d’environnements juridiques favorables à la société civile. Comme nous l’avons dit auparavant, très souvent,
la réforme juridique n’est qu’une étape d’un proc essus conçu pour favoriser l’engagement effectif de la
société civile dans le développement et la démocratie. Les organisations internationales devraient d onc
examiner la manière dont leurs intentions de soutenir la réforme juridique s’inscrit dans leurs s tratégies de
soutien à la société civile.
Après l’examen de certaines critères de seuil, cette partie étudiera les stratégies de réforme dans trois
domaines distincts mais corrélés : (1) les améliorations du cadre juridique , (2) les améliorations de la mi se en
œuvre du processus, et (3) dans des circonstances particulièrement difficiles, les stratégies potent iellement
adaptées à la défense de la société civile ou à l’établissement des bases d’une réforme future.
A. Critères de seuil
1) Volonté politique
Pour réformer le cadre juridique et réglementaire ou améliorer sa mise en œuvre, le gouvernement
devrait d’abord reconnaître ce besoin et rendre prioritaire l’initiative de réforme face aux autres
objectifs gouvernementaux. Cela peut paraître évident, mais cette perspective est parfois négligée.
Dans certains cas, des représentants des OSC ont lancé des initiatives de réforme sans le soutien o u la
participation du gouvernement. De telles initiatives indépendantes de réforme peuvent, par la suite, faire
l’objet d’un appui gouvernemental. Dans d’autres, même si le gouvernement soutient initialement l’effort de
réforme et en profite pour se débarrasser du fardeau de l’engagement sur certaines questions, ce der nier
peut s’intéresser ultérieurement à l’orientat ion du processus de réforme, et intervenir, afin de le retarder, ou
de le bloquer. Ainsi, très souvent, le manque de participation gouvernementale s’est en effet tradui t par
l’échec de la réforme. Par ailleurs, chaque élection donne lieu à un remplacement des autorités
Importance de la volonté politique
Afghanistan : très tôt (en 2002), le gouvernement de transition a reconnu que le cadre juridique datant du
régime des Talibans était insuffisant. Il a soutenu le processus de réforme durant l’année qui suiva it, mais des
changements de direction au sein du ministère chargé de la réforme ont fini par étouffer la volonté politique. C e
n’est qu’en 2005 que le gouvernement afghan a renouvelé son engagement pour la réforme législative r elative à
la société civile.
Maurice : si la réforme est toujours en suspens, le gouvernement, en tant que partenaire exécutif du projet de
renforcement de la société civile mené par le PNUD, s’est engagé dans le processus de réforme, ayant reconnu la
nécessité de développer ce secteur.
Serbie : le manqu e de volonté politique constitue , peut -être, le plus grand frein à la réforme depuis 2000. Des
petites fenêtres d’opportunité se sont subitement fermées suite à des changements de gouvernement ou à
l’adoption de nouvelles dispositions constitutionnelles .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 41
gouvernementales qui, soucieuses de se distinguer des efforts de leurs prédécesseurs, risquent de re jeter des
initiatives de réforme existantes.
Les acteurs internationaux 56 pourraient jouer un rôle clé dans le renforcement de la volonté pol itique. En
convoquant les OSC et les autorités gouvernementales pour des discussions, en fournissant des inform ations
comparatives et de l’expertise, en servant de courtier entre les partenaires pour encourager la comp réhension
et le consensus, en donnant simplement par leur participation une plus grande prestige aux discussions, en
organisant des manifestations pour sensibiliser les autorités gouvernementales aux besoins de réform e, les
organisations internationales peuvent aider à construire des passerell es de dialogue, d’éducation et de
compréhension. En effet, toutes les stratégies et approches de réforme données ci -dessous favorisent le
consensus et le renforcement de la volonté politique pour soutenir la réforme juridique .
2)Leadership des institutions e t individus autochtones
Les programmes visant à promouvoir un environnement civique plus favorable auraient plus de chances de
réussir si les institutions et les individus du pays assumaient la responsabilité des activités. Le rôle des
organisations intern ationales, en revanche, est d’agir en tant que catalyseurs dans ce processus, au niveau
politique ou sur le terrain. L’appui international peut prendre plusieurs formes d’interventions, y compris
l’assistance technique, le développement des capacités, le s outien diplomatique, … – mais il ne serait pas
dans l’intérêt de la société civile qu’il dirige exclusivement la rédaction des lois ou les efforts de lobbying. En
épaulant les initiatives locales les organisations internationales renforcent les notions de responsabilité et
d’autonomie, valorisent les valeurs démocratiques et aident à assurer que les lois reflètent les con ditions
locales de façon appropriée.
La gestion locale présuppose la capacité locale. Beaucoup d’organisations internationales consacren t des
ressources considérables au développement des capacités, en ciblant les représentants des OSC, les a utorités
gouvernementales, les juges, les avocats privés et les praticiens. Les capacités peuvent aussi être renforcées
par d’autres interventions : u ne offre d’information comparative et d’assistance technique dans des domaines
pertinents ; des formations visant à transmettre des connaissances clés ou des compétences pratiques ; des
programmes pour former les formateurs, afin d’amplifier l’impacte ; de s cours universitaires, des stages et des
bourses ciblant des étudiants et des praticiens ; la préparation de publications ; des conférences, séminaires et
manifestations internationales. Une meilleure mise en réseau, un accès amélioré à l’information et a ux
ressources et une plus grande efficacité de la communication et de la coordination des OSC, et aussi entre les
OSC et les acteurs gouvernementaux et autres, sont des éléments critiques pour le développement des
capacités locales.
Compte tenu des critèr es de seuil, nous allons considérer maintenant divers types d’intervention adaptés aux
différents contextes. Dans de nombreux pays, il existe une véritable possibilité de réforme juridique . Dans
beaucoup d’autres, la réforme juridique ne serait pas réalisa ble dans l’immédiat. 57 Les organisations
internationales doivent reconnaître les possibilités de réforme et créer des stratégies de réponse a déquates.
56 Comme on l’a déjà mentionné , les « acteurs internationaux » comprennent l’ONU et particulièrement l e PNUD et d’autres
organisations multilatérales telles que la Banque Mondiale, l’OSCE, la Communauté européenne, ainsi que d’autres organisation s
gouvernementales et ONG internationales. Nous reconnaissons la gamme diverse et importante de missions, mandat s, points d’entrée
et outils disponibles en matière de soutien et d’intervention. Ce document ne vise pas une seule org anisation et ne prétend p as
avancer des stratégies appropriées à tout pays. En revanche, il cherche à examiner des questions d’i ntérêt co mmun, relatives à la
réforme ju ridique de la société civile. La stratégie la plus efficace ne peut être déterminée qu’en fonction de la spé cificité de chaque
pays. 57 Voir la partie IV -D pour une discussion des approches potentielles dans les cas où la r éforme judiciaire n’est pas réalisable dans
l’immédiat.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 42
B. Exécution de la réforme juridique
Dans les pays où il existe une véritable possibilité de réforme jurid ique , les organisations internationales
peuvent jouer un rôle de soutien et de facilitateur, pour ainsi galvaniser le processus. 58 La réforme juridique
n’est évidement pas un événement ponctuel, mais plutôt un processus continu et itératif. Ce processu s
s’a ppréhende comme des étapes qui se chevauchent, comprenant une phase d’évaluation, une phase de
rédaction de lois et une phase de suivi et d’appréciation des lois mises en vigueur ultérieurement. Des
interventions de soutien peuvent s’avérer pertinentes à n ’importe quelle (ou chaque) étape. L’implication du
PNUD dans le processus de réforme juridique à Chypre, telle qu’elle est décrite ci -dessous, est un bon exemple
d’appui et de facilitation se déclinant sur plusieurs étapes.
1) Évaluation
Le succès de toute réforme juridique dépend de la qualité de l’évaluation du cadre juridique existant –
l’évaluation est la base sur laquelle se construit la réforme.
En premier lieu, il faut réaliser une analyse contextuelle, c’est -à-dire aller au -delà du droit et son
envi ronnement plus large pour étudier les opportunités et les obstacles à la réforme. Quelques questions à se
poser au début de toute initiative de réforme : Quelle est l’attitude du gouvernement face à la réforme ?
Existe -t-il des opportunités politiques pour la réforme ? Quels sont les obstacles politiques ? Quelle sont les
résultats du secteur des OSC ? S’agit -il du bon moment ? Existe -t-il d’autres préoccupations macro -politiques
(comme par exemple une réforme constitutionnelle ou des élections), qui renden t peu probable une réforme
juridique de la société civile ?
Deuxièmement, la phase d’évaluation devrait inclure une carte des partenaires. La carte des partenai res
développe l’analyse contextuelle pour identifier ceux ayant un intérêt direct dans la promo tion ou
l’obstruction de la réforme des lois. Il est indispensable d’inclure les partenaires dans tous les s ecteurs, en
particulier dans le gouvernement et la société civile. Y aurait -il des OSC avec l’expertise et la capacité
nécessaires pour mener la réf orme ? Si l’attitude du gouvernement est généralement négative, existe -t-il des
alliés potentiels au sein d’un ministère ? Y a-t-il des contacts disponibles au sein du parlement ? Compte tenu
de l’importance primordiale accordée à la responsabilité locale, quels partenaires devraient être impliqués
dans l’évaluation ou dans l’initiative de réforme au sens plus large ? Qui a la capacité d’en assumer leur
défense ?
Troisièmement, il est nécessaire de faire une révision complète et systématique du cadre jurid ique et
réglementaire existant ayant un impact sur la société civile. Evidemment, la portée de cette révisio n variera.
Elle peut être globale, en examinant le cadre général de la société civile, ou plus spécifique, en v isant par
exemple le cadre juridique régissant l’implication des OSC dans les activités économiques ou dans les activités
de plaidoyer .
En tout cas, il faudrait prendre en considération et la loi et la pratique courante. D’ailleurs, com me il est
indiqué ci -dessus, la révision des lois devrai t se faire sous la direction ou, au moins, avec la participation des
avocats locaux (selon la capacité locale). Dans l’idéal, la révision des lois devrait comparer le ca dre juridique en
question aux bonnes pratiques réglementaires internationales.
58 Cette partie porte sur les contextes nationaux où il existe des opportunités identifiables pour la r éforme législative et l’e ngagement
international. Nous reconnaissons bien sûr que très souvent, c ela n’est pas le cas. Les gouvernements peuvent hésiter à considérer la
réforme législative pour la société civile, ou, juger importune l’implication internationale. Dans d es tels cas, les acteurs internationaux
doivent réfléchir à des stratégies de substi tution, qui sont résumées dans la partie IV -D.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 43
Les partenaires
Définition : toute organisation, entité gouvernementale ou individu ayant un intérêt dans ou étant affecté par la
réforme des lois sur l es OSC . Cela comprend:
OSC
Gouvernement : gouvernement central, ministères, collectivités locales, bureaux de liaison
gouvernement – ONG, etc.
Parlement – congrès
Magistrature
Entreprises
Médias
Universitaires
Law students
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 44
Soutien du processus de réforme juridique à Chypre
La stratégie à moyen terme (2006 -2010) pou r l’aide officielle au développement du Chypre met
l’accent sur le rôle des ONG dans l’offre d’aide et la mise en œuvre de projets de développement.
Une étude préliminaire du cadre juridique actuel ayant un impact sur les ONG à Chypre, menée par
le Bureau de Planification National, a souligné certaines lacunes dans la législation et des difficultés
procédurales impactant l’évolution de la coopération ONG -gouvernement. Parmi les contraintes
identifiées figurent l’éligibilité des ONG et leur sélection pour de s financements, les critères de
comptabilité et d’autres conditions, et les contrôles pour sauvegarder les fonds publics. En 2007, l e
Bureau de Planification a demandé de l’aide au projet d’action du PNUD, pour la coopération et la
confiance à Chypre (UNDP -ACT).
Par la suite , l’UNDP -ACT a soutenu le centre européen sans but lucratif (ECNL) pour organiser un
certain nombre de consultations avec les OSC et le bureau de planification, afin de réaliser une
évaluation détaillée du cadre juridique et institution nel existant à Chypre et émettre des avis pour
des consultations et actions supplémentaires. Le rapport a conclu que le changement vers un
environnement plus propice aux OSC serait un effort de longue haleine.
En 2008 , l’UNDP -ACT a consacré des moyens add itionnels pour faire avancer le programme de
réforme, avec l’expertise et le conseil constants de l’ECNL. Cela a donné lieu à :
La mise en place d’un comité consultati f/groupe de travail conjoint et transversal, sous l’égide
du Bureau de Planification Nat ional, avec des représentants du gouvernement, des OSC et
ONG ainsi que des avocats ;
Le renforcement de la capacité des partenaires à soutenir la réforme du cadre institutionnel
dans lequel fonctionne la société civile chypriote, grâce, entre d’autres ac tivités, à une visite
pédagogique en Hongrie, facilitée par l’ECNL.
Défis
La diffi culté pour surpasser le manqu e de confiance et l’antagonisme qui marquent les
rapports ONG -gouvernement ;
La gestion d’attentes différentes – les ONG s’attendent à des grand s bouleversements du
statu quo, tandis que le gouvernement considère que son simple engagement dans un
processus de réforme constitue un pas de géant ;
Le manque de coordination entre les différents services gouvernementaux.
Réussites
Le groupe de trava il des ONG, récemment mis en place, est devenu une plateforme d’activité
en termes de réforme institutionnelle, au sein du secteur des ONG ;
Le gouvernement s’est engag é à contracter de nouvelles expertises ju ridiqu es, afin de rédiger
de nouvelles lois co ncernant la déclaration et le fonctionnement des associations, des
fondations et des clubs, ainsi que la création d’un statut d’intérêt public.
Leçons apprises
L’implication de tous les partenaires pertinent s contribu e de manière significative à
l’avancem ent du processus de réform e, puisqu’ils deviennent tous responsables de ce
processus et cela les incite à le suivre de très près.
Involving the NGO sector in a reform process that affects them directly supports the
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 45
Une fois terminée, on devrait considérer la publication des résultats de l’évaluation du cadre juridique . La
distribution aux principaux partenaires des versions préliminaires de la révision juridique , pour leurs
commentaires et appréciations, est une façon g arantie d’inclure un éventail plus large d’acteurs dans la phase
d’évaluation. De même, les débats publics sont un instrument très utile pour favoriser une plus gran de
participation au processus. L’évaluation définitive devrait être distribuée au -delà du c ercle des partenaires
primaires, à tous les membres concernés de la communauté d’OSC et de la sphère gouvernementale. Une
évaluation complète constituera, pour les partenaires locaux, une base solide pour le choix d’une st ratégie de
réforme. Elle devrait n on seulement identifier des domaines nécessitant une réforme et des solutions
alternatives, mais aussi, de façon idéale, aider les partenaires à reconnaître l’intérêt de la pours uite de cette
réforme.
2) Intérêt dans la réforme
Les organisations internatio nales peuvent aider les partenaires locaux à mettre l’accent sur des questions
juridique s relatives aux OSC. Il est certain que l’engagement des partenaires locaux dans la phase initiale
d’évaluation, dans la réalisation de recherches de base et dans la po ndération de solutions éventuelles, accroît
indiscutablement l’engagement local au processus. Néanmoins, tous les processus de réforme ne sont p as
sans heurt. Au contraire, pour diverses raisons (des élections par ex.), il peut y avoir un interval le consid érable
entre la phase d’évaluation et la rédaction des lois, cela annulant ainsi le dynamisme de réforme qu i aurait pu
exister.
Comme souligné ci -dessus, la réforme juridique en Serbie a perdu de la vitesse à plusieurs reprises, à cause, en
grande partie, de facteurs macro -politiques. Si les partenaires majeurs venant de la communauté d’OSC
reconnaissent la nécessité de réformer, leur capacité à faire du lobbying ne cesse de croître et déc roître,
tandis que le sentiment de frustration s’est constamment int ensifié au cours des cinq dernières années. Dans
de telles circonstances, les organisations internationales peuvent être un appui fondamental, en tirant
l’attention sur le besoin permanent de réforme. Cela peut se faire de plusieurs façons, notamment en
so utenant les acteurs nationaux dans l’organisation de campagnes ou de manifestations de sensibilisati on, de
réunions tran s-sectorielles avec tous les partenaires et d’ateliers sur place, ainsi qu’en facilitant la participat ion
des acteurs nationaux aux évèn ements internationaux et en partageant des pratiques internationales. Au
Sierra Léone, par exemple, le PNUD a joué un rôle clé en informant les ONG des propositions de loi e t en
réunissant les OSC et le gouvernement pour discuter des préoccupations de chaq ue partie. Le forum
consultatif ONG -PNUD a créé un comité chargé d’étudier de près les propositions de loi sur les ONG et de faire
des recommandations sur des questions concernant la réforme.
Pour susciter du dynamisme, les organisations internationales p euvent être tentées de compenser les
législateurs locaux. Certes, d’un côté cela semblerait être un moyen direct de faire avancer l’initi ative de
réforme juridique , tout en favorisant la responsabilité locale. Toutefois, la compensation peut s’avérer être
une incitation perverse, qui fait avancer l’initiative de réforme incontestablement, mais pour les m auvaises
raisons. Autrement dit, l’incitation financière peut déséquilibrer le jugement des partenaires princ ipaux. Si la
Réflexions sur l es cons équences de la réforme
En Slova qu ie, l’adoption d’un mécanisme d’allocation s fiscal es (permettant aux contribua bles et aux
sociétés d’attribuer jusqu’à 2% de leurs impôts à une OSC qualifiée) a fini par éliminer les incitations aux
donateurs, qu’ils soient des particuliers ou des sociétés, (c’est -à-dire les exonérations fiscales offertes aux
donateurs des OSC ). Les défenseurs des systèmes d’attribution fiscale devraient bien considérer les
risques et avantages potentiels pour le secteur avant de lancer de telles initiatives de réforme fis cale. En
effet, les partenaires peuvent vouloir identifier les facteurs influan t sur la décision « réformer ou ne pas
réformer ».
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 46
réforme ne peut pas avoir lieu san s compensation, la responsabilisation locale paraît douteuse. La
compensation pour la rédaction de lois est une épée à double tranchant, et elle mérite d’être consid érée avec
la plus grande précaution.
3) Groupes de rédaction représentatifs de tous les par tenaires
Basée sur une évaluation solide et alimentée par l’engagement des partenaires locaux principaux, la rédaction
juridique peut, au début avancer d’un pas décidé. A cette étape, les organisations internationales peuvent
jouer un rôle critique en sout enant un processus participatif. D’ailleurs, le succès d’un projet dépend très
souvent du degré auquel le processus de réforme encourage la participation de toutes les parties
potentiellement intéressées. Un processus qui prend en compte les points des vue des OSC, des autorités
gouvernementales, des parlementaires et des autres camps, donnera lieu à une meilleure législation, qui aurait
plus de chances d’être mis en vigueur, engendrerait plus d’intérêt quant à son application et serait mieux
respectée une fois entrée en vigueur. Cela suscitera en plus d’avantage d’intérêt dans la suite du processus de
réforme.
Naturellement, ce type de coopération fait souvent face à des obstacles, tels que le manque de coord ination
entre les ministères et, des fois, l’an imosité ouverte entre le gouvernement et les OSC. En effet, ces obstacles
représentent l’un des plus grands défis pour la rédaction réussie des lois. Pour les surmonter, les organisations
internationales peuvent servir de rassembleurs, en réunissant les pa rtenaires et en créant un espace
d’échange d’information. L’échange d’opinions et de données peut faciliter le rassemblement de perso nnes
ayant des points de vue divers. La création d’un groupe de rédaction trans -sectoriel, composé de plusieurs
partenaires , peut être particulièrement utile pour l’examen des questions non résolues . Il faudrait, bien sûr,
faire très attention au choix des représentants des OSC, puisque les organisations internationales ne
conna issent qu’une partie limitée de la société civil e d’un pays. En outre, le gouvernement peut favoriser la
participation exclusive de certaines OSC sympathisantes, créant ainsi l’illusion d’un consensus exte nsif, mais
excluant en réalité d’autres acteurs critiques.
Ne demander l’apport des OSC qu’après l a diffusion par le gouvernement d’une version initiale, limite
considérablement les possibilités d’obtenir des contributions pertinentes. Avec des groupes de trava il trans –
sectoriels, les parties ayant des divergences d’opinion ont plus de chances de trouv er des terrains d’entente.
L’appui des acteurs internationaux peut être indispensable pour la création de groupes de rédaction trans –
sectoriels, dès le début du processus de rédaction.
Créer de l’ intér êt pour la réforme
Honduras : En 2003, l’ICNL a lancé un projet de partenariat pour faciliter la réforme environnementale ( « PEER ») au
Honduras. Grâce à PEER, l’ICNL a pu travailler ave c la fédération des ONG honduriennes, un regroupement de 70
organisations de développement social, pour redynamiser les efforts de rédaction d’une loi gouvernan t les ONG. Des
tentatives au cours de la dernière décennie ont échoué parce que les ONG étaient incapables de se mettre d’accord sur
certains éléments clés de la réforme, y compris les normes juridiques adéquates pour la comptabilité au sein des OSC . Le
projet PEER a facilité le consensus parmi les OSC – une évaluation externe du projet en 2006 a con clu que « la
communauté des ONG, avec le soutien du projet PEER, a pu trouver un terrain d’entente : un accord de base pour la
rédaction du projet de loi sur les ONG ».
Viet nam : Le gouvernemen t vietnamien hésitait à entreprendre une réforme législative du secteur des OSC . L’ ICNL a
travaillé de manière assidue avec le PNUD et des partenaires locaux pour maintenir un niveau « diplomatique » de
dynamisme , ce qui a provoqué une approche gouvernementale plus constructive de la réforme.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 47
4) Participation du plus grand nombre
Si, dans tout groupe de rédactio n, le nombre de participants doit forcément rester limité pour des raisons
d’efficacité, il est nécessaire que tous les partenaires intéressés aient l’occasion de contribuer à la réforme
juridique . Garantir la participation du plus grand public est capital , pour donner une légitimité plus grande à
l’initiative de réforme.
Plusieurs pratiques innovantes ont été développées pour renforcer la participation du grand public:
La diffusion du projet de loi à la grande communauté d’OSC par courrier électronique, avec une
demande de retour ;
La publication du projet de loi dans un grand journal national, pour encourager la participation des
représentants des OSC et du public en général ;
La mise en place d’un site web consacré à l’initiative de réforme juridique , avec des mises à jour
régulières et une adresse e -mail pouvant servir aux partenaires intéressés pour envoyer leurs
contributions;
Des réunions d’experts avec plusieurs groups ciblés, par exemple les universitaires, les donateurs, les
avocats et certain s bénéficiaires ;
Des réunions dans les mairies pour promouvoir la participation du public, avec l’enregistrement des
commentaires, qui influencent parfois les versions finales des lois ;
Des ateliers et débats publics, au niveau national, pour présenter les projets de loi, demander des
contributions et valider des propositions;
Des conférences internationales pour avoir l’apport d’experts mondiaux et de partenaires nationaux.
Groupes de rédaction tr ans -sectoriels
L’Afghanistan : Le co ntraste entre les deux processus de réd action en Afghanistan illustre l’importance d’un engagement
trans -sectoriel dans la rédaction des lois. Le groupe de rédaction législative, créé en 2002/2003, a travaillé dès le déb ut
avec la participation de la société civile. Par conséquent, le projet de loi était relativement prog ressif et il avait le sou tien
des partenaires des deux secteurs. En 2005, le processus de rédaction définitive a été dirigé par le gouvernement, qui n’a
permis la participation de la société civile qu’à contrecœur. Par ailleurs, le processus était moins réfléchi et plus précipi té.
Ainsi, la loi promulguée ultérieurement offrait moins de possibilités que celle de 2003, même si elle représentait une
avancée progressiste de considérable.
Le Mexique : Pour promouvoir et assurer l ’adoption d’une législation visant à faciliter le développement de la
philanthropie et de la société civile au Mexique, quatre organisations ont créé un groupe de travail , chacun appo rtant
des compétences et expertises spécifiques, pour contribuer à un effort de réforme bien coordonné. L’Institut o
Tecnol ógico Autónom o de México est une université et un centre de recherche , capable de réaliser des études et de
fournir des preuves empiri ques pour soutenir les arguments en faveur de la réforme. L’Indice Social est une organisation
d’intérêt public qui est connue et respectée par des OSC dans tout le Mexique. Consultante en communication, Cristina
Galindez est experte en lobbying et connaît le processus législatif en profondeur. Finalement, l’ICNL apporte des
données internationales et comparatives, pour renforcer l’argumentation en faveur de la réforme.
La Tanzani e : Un groupe de travail constitué d’OSC et d e fonctionnaires rattachés au bu reau du Premier Ministre Adjoint a
dirigé les modifications de la loi sur les ONG via le Conseil des Ministres et le Parlement, amélior ant ainsi, de façon
notable, l’environnement législatif du secteur.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 48
S’il n’y a pas suffisamment de participants, on pourrait courir le risque de passer à côté de certains
éclaircissements précieux et quelques OSC peuvent percevoir l’initiative de rédaction comme étant le travail
d’un groupe d’élites, ainsi érodant la légitimité
de la réforme. Le manque d’un sentiment
généralisé de responsabilité locale entraverait
très certainement l’efficacité de la mise en
œuvre. En se servant de cette gamme de
mécanismes participatifs disponibles, les acteurs internationaux peuvent jouer un rôle clé pour faci liter un
processus qui offre le temps et l’espace né cessaires pour une participation du plus grand nombre.
5) Les liens transfrontaliers
Les liens régionaux et internationaux confirment et renforcent l’engagement des partenaires locaux, tout en
affinant leurs compétences, en leur offrant des informations comparatives et des expertises. Les
organisations internationales doivent être conscientes des bénéfices potentiels des liens transfront aliers et
des moyens les plus efficaces de les faciliter. Des liens réussis ont été établis via des consultati ons
transf rontalières et par des conférences, des séminaires, des voyages d’étude, des bourses, des réseaux
universitaires et d’autres activités régionales.
L’information peut se transmettre entre les pays d’une région donnée. Depuis 15 ans, les pays d’Euro pe
cent rale et orientale échangent des idées et jouissent des bénéfices mutuels de tels échanges. En 2006, plus
de 175 représentants de la société civile, des gouvernements, du secteur privé et des universités on t participé
au Forum Hondurien pour le Droit à But Non Lucratif, y compris des experts venant du Costa Rica, du Salvador,
du Chili et du Venezuela. L’avocat nigérien, Emeka Iheme, a servi de ressource pour les initiatives de réforme
juridique en Tanzanie et, de façon plus générale, en Afrique subsaharienn e. David Lidimani, un avocat des Îles
Encourager la participation du public
Mexique : Un groupe de travail cherchant à promouvoir la réforme des lois gouvernant la société civile a : (1)
organi sé 6 réunions d’experts ( avec 150 représentants des OSC et du gouvernement) pour présenter des
informations, demander des contributions aux OSC , concern ant les défis auxquels elles font face, et travailler
ensemble sur des recommandations ; (2) publié un rapport – La Définition d’un Agenda Fiscal pour le
Développement des Organisations de la Société Civile au Mexique – comprenant l’apport de ces réunions
participatives ainsi que des propositions concrètes de réforme législative ; et (3) élargir la participation, grâce à un
site web consacré à l’initiative de réforme.
Pacifique Sud : Dans les îles du Pacifi que Sud, de nombreux secteurs de la société sont t rès souven t exclus de la
formulation de politiques publiques. Dans son programme sur les lois de la société civile, l’ICNL a essayé
d’assurer la plus grande participation en visitant les îles éloignées de chaque nation insulaire ; en visitant non
seulement les grandes villes mais aussi les villages et les communautés locales ; et en rencontrant les
regroupements de chefs et les groupes ethniques majoritaires et minoritaires. L’ICNL a ainsi servi d e chaine de
communication entre le gouvernement et le public . Dans certaines de ces nations, le consensus est de plus en
plus important, concernant les réformes défendant ces regroupements, ou permettant à d’autres
organisations de les représenter et les servir. Ces petit s pas vers l’établissement d’un consensus f ont
considérablement avancer la démocratie participative .
“L’un des meilleurs aspects de ces deux
conférences, c’est qu’elles ont facilité la
création d’un grand réseau de « réform ateurs »
arabes, qui ont gardé le contact, pour
s’informer sur ce qui s e pass e dans leurs pays
respectifs et pour discuter de stratégies et
d’idées permettant de poursuivre la réforme
partout dans la région. »
Kareem Elbayar, Consultant juridique pour le
Moyen Orient et l’Afrique du Nord, ICNL
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 49
Salomon, soutient la réforme des structures juridique s de la société civile à Samoa, au Vanuatu et ailleurs dans
la Pacifique. En 2006, une réunion préparatoire de la société civile a précédé le Forum pour l’Aveni r, en
réunissant des individus venant de 13 pays arabes, afin de discuter des priorités, des objectifs et des stratégies
nécessaires à la création d’un environnement juridique plus propice à la société civile, et ce, pour le monde
arabe. Cette réunion a donné l ieu à une Déclaration par les représentants des OSC sur les priorités de la
réforme de la société civile. Elle a eu lieu après une conférence à Be yrouth, qui a servi de tribune aux
reformeurs arabes, pour discuter de stratégies de réforme pour la société c ivile.
L’information peut également circuler entre les régions. Les pays de l’ancienne Union Soviétique tir ent
régulièrement des leçons des pratiques de l ’ECO pour améliorer leurs propres processus de réforme. Par
ailleurs, les pays du Moyen Orient ont ét udié l’expérience de transition des pays de l ’ECO (PECO) . La nation
insulaire africaine de Mauritanie s’est inspirée des pratiques réglementaires européennes lors de la révision de
son propre cadre juridique . Les rédacteurs législatifs en Afghanistan ont c herché à obtenir des données
comparatives des états avoisinants de l’Asie centrale, de l’Europe et des États -Unis. En novembre 2005, lors
d’un Forum Globale sur la Législation de la Société Civile organisé par l’ICNL, des représentants de l’Amérique
du Nor d, de l’Amérique Latine, de l’Afrique, de l’Europe, du Moyen Orient et de l’Asie ont participé et pa rtagé
leurs expériences. Évidemment, les organisations internationales ont un rôle décisif à jouer en faci litant des
tels liens.
Les organisations régional es, telles que l’Union africaine, le Conseil de l’Europe ou l’Organisation des États
américains (OEA), peuvent aussi faciliter le soutien transfrontalier. Récemment, un projet de loi su r la
coopération internationale avait suscité des peurs au Venezuela, q ue le gouvernement aurait le pouvoir inédit
de contrôler le financement des OSC actives dans le domaine de la coopération internationale. Pour e mpêcher
cela, plusieurs OSC vénézuéliennes ont tenté
de bloquer le projet de loi en se servant de
liens transfro ntaliers pour :
Participer à des auditions de l’OEA sur
le projet de loi ;
Participer à des réunions du MercoSur,
l’union douanière de quatre pays
(l’Argentine, le Brésil, le Paraguay et l’Uruguay), en mettant l’accent sur le lien entre les droits de
l’h omme et le projet de loi ;
Participer à toutes les conférences régionales et internationales offrant des occasions de parler de la
loi et de son impact potentiel sur le secteur des OSC au Venezuela.
D’une manière globale, on peut estimer que ces efforts o nt influencé la décision du Congrès vénézuélien de
retarder son examen du projet de loi.
6) Assistance Technique
« Tu avais presque le monde entier dans une
même salle à discuter et à s’entraid er au sujet
de la législation de la société civile, dans
différentes nations , partout dans le monde. »
Kefale Belachew, LLB , Directeur Général de l’ AEPA,
Éthiopi e
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 50
Comme souligné ci -dessus, l’expertise internationale comparative est d’une importance fondamentale pour la
réforme, particulièrement dans des co ntextes où l’on manque de compétences locales. Même dans des
situations où la capacité juridique locale est de haute qualité, il y a inévitablement des aspects qui peuvent
bénéficier d’une perspective juridique plus large. Les acteurs internationaux peuven t fournir une assistance
technique en ouvrant le processus aux organisations internationales de consultation et en coordonnan t
l’apport des donateurs. De plus, il faut reconnaître que l’assistance technique est généralement plus efficace
quand elle est fou rnie par des experts indépendants, que quand elle vient de ceux qui sont perçus comme
étant partisans ou en faveur de certaines positions. Les organisations capables de se positionner en
« modérateur » auront plus de crédibilité aux yeux du gouvernement. I ci, encore une fois, les organisations ont
certainement un rôle clé à jouer.
C. Poursuite de la réforme juridique
1) Assistance pour la mise en vigueur
Une fois la réforme juridique achevée, le défi, c’est de la mettre en vigueur. En effet, la mise en œuvre
progressive, consistante et apolitique pose, en général, encore plus de problèmes que l’évolution juridique .
Pour soutenir la bonne mise en vigueur des lois, les organisations internationales doivent jouer un rôle
important en renforçant (1) la form ation des régulateurs gouvernementaux ; (2) la formation des praticiens
du secteur des OSC ; (3) la préparation de documents éducatifs au bénéfice des deux secteurs ; et (4) les
campagnes de sensibilisation du public pour que ce dernier puisse comprendre le besoin de réformer.
Assistance Technique
Le rôle d’un cons ultant international est de :
Donner une perspective indépendante et technique aux questions national es;
Offrir une expertise internationale comparative sur les aspects réglementaires en question ;
Aider les partenaires locaux à appr éhender les approches réglementaires alternatives qui sont disponibles,
leurs avantages et désavantages, et les conséquences des diverses options législatives ;
Préconiser un processus de réforme l égislative qui est convenablement inclusif et participatif ;
Promouvoir un proc essus de réforme législative qui favorisera un cadre légal plus respectueux des lois et
des bonnes pratiques internationales ;
Soutenir, et non pas supplanter, les partenaires loca ux ;
Responsabiliser les partenaires locaux, et non pas rédiger directemen t les lois et les mesures législatives.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 51
La formation peut prendre la forme de séminaires et d’ateliers sur le nouveau cadre juridique , d’assistance
technique directe et d’initiatives transfrontalières, pour citer quelques possibilités. Dans le cont exte de la loi
sur la so ciété civile, l’assistance à la mise en vigueur peut impliquer des questions de déclaration, de fisc alité,
de surveillance et de suivi. Les formations peuvent cibler les responsables de la déclaration, de la fiscalité ou
de la surveillance, ainsi que les j uges. Les besoins de mise en vigueur comprennent souvent la création de
registres centraux, la préparation de règlements concernant la mise en œuvre et la rédaction de form ulaires et
de documents modèles pour la déclaration et le signalement (y compris des actes fondateurs, des règlements,
des formulaires de signalement et d’autres formulaires standardisés).
L’éducation des OSC peut aussi bénéficier de méthodes similaires. Une autre approche qui peut s’avér er
efficace serait un programme pour former les fo rmateurs, qui permettrait de démultiplier l’impact d’une seule
formation. Des formations ciblant les avocats peuvent aussi être utiles pour créer un réservoir d’ex pertise
juridique en matière des lois gouvernant la société civile au sein d’un pays. D’aille urs, il est souvent intéressant
de réaliser des formations trans -sectorielles, qui favorisent non seulement une meilleure communication entre
les secteurs, mais aussi un renforcement des capacités dans chaque secteur respectif. Les publicati ons
éducatives peuvent inclure des brochures faciles à lire pour ceux qui ne sont pas avocats, des manuels avec
des commentaires détaillés sur les lois pertinentes pour des régulateurs gouvernementaux et pour des
praticiens, des analyses comparatives, des guides pratiqu es, etc. Le processus d’écriture lui -même est un outil
indispensable pour le développement des capacités, dans l’optique de souligner la responsabilité loc ale, tant
dans la mise en place que dans l’élaboration de la réforme juridique .
2) Suivi et évalua tion
Étant donné que même les lois bien rédigées ne sont pas forcément bien appliquées, le suivi et l’éva luation du
processus de mise en vigueur sont nécessaires pour l’améliorer et pour appuyer les réformes juridique s en
cours. Il faudrait penser aux méca nismes de suivi et d’évaluation même avant d’achever la réforme juridique ,
pour assurer que tous les acteurs soient d’accord, non seulement sur les outils disponibles, mais au ssi sur les
conséquences de ce suivi. Des indications et des principes de suivi, définis au préalable, peuvent empêcher des
conflits entre le gouvernement et les OSC. Tous les mécanismes gouvernementaux existants pour évalue r la
Soutien aux gouvernements pour la mise en œuvre ’Afghanistan : Le service des ONG (responsable de la
déclaration et de la surveillance des ONG) au sein du Ministère de l’ Économie en Afghanistan a demandé et
reçu de l’aide pour créer un registre central informatisé des ONG.
Pér ou : l’Agence Péruvienne pour la Coopération Internationale (APCI), responsable de la rédaction de deux
règlements de mise en vigueur, a sollicité des contributions internationales sur le cont enu provisoire de ces
règlements.
Russie : Malgré le caractère régressif des modifications au cadre légal des ONG en Russie, le gouvernement a
tout de même demandé de l’assistance technique pour préparer les règlements de mise en œuvre pour ce s
modificati ons. Cela souligne, pour les acteurs internationaux, l’importance de maintenir la vigilance afin
d’intervenir positivement dans de telles occasions.
Tanzanie : À travers des ateliers approfondis, dans les mois suivant l’adoption d’une loi modifiée, l’ICN L a
fourni une formation de base aux autorités gouvernementales et à la commission gouvernement/ONG, sur la
mise en vigueur de cette loi modifiée .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 52
performance des ministères et des bureaux, en matière d’application juridique , devraient faire l’objet d’une
attention particulière.
Une autre approche d’une valeur potentielle est la facilitation du travail des « chiens de garde », c’est -à-dire
les organisations consacrées à la surveillance de la performance gouvernementale, là où le contexte le
permet. De man ière générale, ces organismes peuvent suivre les promesses électorales des élus ainsi que la
mise en œuvre de diverses politiques et de lois. Cela favorise une certaine transparence dans le
fonctionnement du gouvernement, offre des informations supplémenta ires au public, et encourage
l’amélioration de la performance gouvernementale.
En 2006, l’évaluation de l’impact des modifications à la législation sur les ONG en Russie a suscité un
intérêt considérable au sein du secteur russe des OSC et dans la communau té internationale plus
largement. Par conséquent, on a développé un outil spécifique à la Russie, pour suivre et surveiller la
mise en vigueur de la législation récemment adoptée, mais cet outil pourrait s’adapter à d’autres
contextes. Il peut servir pour apprécier des éléments ayant la capacité de devenir des sources de
contraintes gouvernementales pour la société civile, tels que :
La déclaration : l’organisme de déclaration est -il politisé? Les procédures sont -elles lourdes? Les
autorités ont -elles le po uvoir de refuser la déclaration ?
La gouvernance interne : le gouvernement a -t-il le droit d’assister aux manifestations de l’organisation,
y compris aux réunions du conseil d’administration ? Peut -il remplacer les membres du conseil
d’administration ?
Les activités : les activités « politiques » ou « extrémistes » non définies sont -elles interdites par la loi ?
Les ONG peuvent -elles fournir des services ?
La durabilité : la loi permet -elle aux organisations de recevoir des financements étrangers ou d’êtr e
payé pour des services fournis?
La réglementation : le gouvernement a -t-il le droit d’auditer les organisations ? Si oui, pour quelle raison
et avec quelle fréquence ? A -t-il le droit d’émettre des avertissements ou de dissoudre les
organisations ?
Le m écanisme de suivi doit s’adapter au contexte local. Pour déterminer si cela est le cas, il faut abso lument
répondre à certaines questions :
Quel est le public ciblé et comment va -t-il utiliser les données de suivi ?
Quelles lois seront évaluées pour le ur impact (ex. une seule loi ou le cadre juridique entier) ?
Quel niveau d’impact devrait être évalué (ex. l’impact sur des organisations individuelles, sur le n iveau
sectoriel, ou sur toute la société) ?
Quels groupes devraient être ciblés lors de l’é valuation (ex. certains types d’organisation en
particulier, des organisations impliquées dans une activité spécifique ou dans des zones
géographiques identifiées) ?
Quelle méthodologie devrait être utilisée pour recueillir des données (ex. des sondages auprès des
organisations, des statistiques gouvernementaux, des groupes de discussion ou des entretiens
structurés) ?
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 53
Qui devrait participer au processus de suivi (ex. les représentants des ONG locaux et internationaux ,
des donateurs, de la communauté diplomatique, du gouvernement hôte, du parlement, du monde
universitaire, ou même du monde de l’entreprise) ?
D. Au -delà de la réforme juridique
La réforme juridique ne serait évidemment pas une option réaliste dans tous les contextes. Certains pays
ris quent d’être insensibles aux incitations à réviser leurs lois dans l’immédiat. Dans des telles situa tions, le
soutien à la société civile devrait passer par d’autres approches. Cette partie cherche à éclairer l es stratégies
alternatives potentielles.
Un c ritère de seuil à ne pas négliger est le besoin de développer et mettre en place le soutien à la soc iété
civile, dans le long terme. Plusieurs stratégies seront naturellement liées au développement des cap acités des
acteurs potentiels de la réforme, qui ne pourront agir que si le paysage politique leur offre l’occasion de le
L’expérience éthiopienne : après la réforme législative
Même dans des situations où la réforme légis lative a été régressive, les organisations internationales
peuvent jouer un rôle clé après la réforme, comme le démontre l’expérience de l’Éthiopi e.
Si le gouvernement éthiopien a reconnu la contribution des OSC , il soutenait que pour améliorer le
développement , maîtriser la corruption et compléter ses efforts il devait construire un cadre directeur qui
servirait à réguler la composition et la nature des organisations opérant en Éthiopie. Vers la fin d e 2007, il a
publié une version initiale de la Proclamation s ur les Organisations Caritatives et les Associations. Cette
proclamation est assez controversée, puisque les OSC considèrent qu’au lieu d’améliorer leur
développement, elle restreint leur fonctionnement. Plus spécifiquement, elle décrète que : les organisa tions
éthiopiennes impliquées dans certaines activités désignées, telles que l’avancement des droits de l’ homme
et les droits démocratiques, ne peuvent recevoir que 10% de leurs financements de sources étrangères ; 70%
de leur budget doit être réservé aux activités programmatiques et un maximum de 30% peut être utilisé
pour des coûts administratifs ; les associations doivent obtenir un permis pour des collectes publiques ;
l’Agence pour les Organisations Caritatives et les Associations a le pouvoir de lance r des enquêtes dès
qu’elle le juge nécessaire.
L’ONU s’est inquiétée de ce projet de proclamation et a préconisé des révisions de certains articles pour
créer un environnement plus propice aux opérations des ONG. De plus, le PNUD, en tant que secrétaria t d u
Groupe d’Aide au Développement, une source de financement, a interpellé le gouvernement au sujet de la
proclamation. Malgré cela, la Proclamation n° 621/2009 sur les Organisations Caritatives et les Associations
(PCS) fut adopté en février 2009.
L’UNCT est actuellement en train d’analyser cette loi, par rapport à ses implications programmatiques pour
la mise en œuvre de l’UNDAF et d’autres projets soutenus par le système ONU, et pour déterminer sa
compatibilité avec des instruments régionaux et internat ionaux afin de sauvegarder les droits de l’homme .
Les donateurs internationaux travaillent aussi sur des strat égies d’interpellation, maintenant que la loi a été
adoptée. Ces stratégies comprennent :
Le suivi de l’application et de l’impact de la l égisla tion sur l es ONG éthiopiennes et international es ;
Le sout ien et le renforcement des capacit és des ONG éthiopiennes et international es à s’adapter et
répondre à un nouvel environnement de fonctionnement ;
La garantie que les voies et programmes pour le dé veloppement des dons et pour le financement
d’aide humanitaire s’adaptent aux critères de la Proclamation , de façon à ne compromettre ni la
livraison efficace de ressources aux bénéficiaires ni l’impact réel des dons .
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 54
faire, ce qui pourrait prendre des années. Certes, toutes les stratégies devraient, de manière idéal e, faire
partie d’une vision à long terme, mais, dans certains cas, il ne serait pas réaliste d’insister sur des résultats à
court terme. Même les approches qui semblent avoir un effet immédiat (telle que la sensibilisation d u public
sur l’affaiblissement de la société civile) ne représenteraient, en fin de compte, qu’un pas sur le long ch emin
vers un environnement réformé. 59
1) Soutenir les alliances et les réseaux
Dans des environnements politiquement difficiles, la création et l’entretien d’alliances et de résea ux peuvent
s’avérer très précieux pour protéger et renforcer les OSC individuels et la société civile en général. Dans de tels
contextes, le secteur des OSC peut être divisé, rendant difficile ou simplement symbolique toute ten tative de
former des réseaux. Cependant, la mise en réseau présente des bénéfices de partage de données,
d’am élioration de l’accès à l’expertise, d’inspiration en s’appuyant sur le fait de ne pas se sentir seu l dans la
défense des droits de l’homme et la protection d’organisations et d’individus militant dans des
environnements répressifs. Les organisations inter nationales peuvent servir de catalyseur pour convoquer et
animer des tels réseaux, qu’ils soient nationaux ou internationaux.
2) Sensibiliser le public
Dans pratiquement tous les contextes, la sensibilisation du public est indispensable pour travailler
effi cacement avec la société civile. Qu’il s’agisse d’une réforme juridique , des rapports OSC/gouvernement ou
de l’image publique du secteur civil, toute action pour informer et éduquer – pour sensibiliser – est
fondamentale pour aborder la question. Les actio ns de sensibilisation peuvent cibler la communauté des ONG
en général, ou des organisations internationales ainsi que d’autres nations et des entités multilaté rales. Elles
sont très probablement au cœur des stratégies d’interpellation de la société civile, et ce dans les pays
développés comme dans les pays en voie de développement, même si les méthodes privilégiées varient s elon
le contexte.
En plus de renforcer les capacités relatives aux techniques de sensibilisation (voir ci -dessous), les
organisations internationales peuvent offrir un appui significatif en tant qu’observateurs indépendants. Grâce
à la recherche, aux enquêtes, à la documentation, à l’analyse et à la dénonciation de menaces, d’abu s et de
problèmes existants, les actions de sensibilisatio n peuvent être mieux programmées et réalisées. Il existe
plusieurs indices de classement, qui proposent des outils comparatifs pour mesurer, pays par pays, l e respect
accordé à différentes mesures objectives. Par exemple, le nouveau Conseil des droits de l ’homme de l’ONU a
59 Ces stratégies pour protéger la société civile sont basées sur des recherches menées par l’ICNL et présentées dans l’article
« Safeguarding Civil Society », paru dans l’International Journal for Not -for -Pro fit Law , Vol. 9, N° 3, juillet 2007.
Interventions de soutien
Faciliter la création de l’alliance ou du réseau en convoquant les membres potentiels ;
Fournir de l’information et de l’expertise technique aux réseaux existants ;
Organiser des réunions nationales ou internationales pour renforcer les réseaux ;
Apporter une reconna issance ou un « manteau de protection » aux réseaux, ainsi qu’une certaine influence
internationale. Dans des cas de répression, les organisations internationales peuvent même, jusqu’à un
certain degré, protéger contre la violence et l’oppression ;
Soute nir des groups en exil qui travaillent au nom de la société civile dans des pays comme la Birmanie
(Myanmar) et le Turkménistan.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 55
créé l’Examen Périodique Universel (ou UPR en angla), qui aura comme objectif de mesurer les perform ances
des États membres de l’ONU, en matière des droits de l’homme, au moyen d’un mécanisme commun .60
3) Développer les capacités
Le rôle l e plus important que peut jouer une organisation international est peut être celui de développer la
capacité des OSC locaux d’organiser ou de participer aux processus de réforme juridique et de défendre la
société civile, même dans des cas où la réforme n’ est pas possible dans l’immédiat. Compte tenu de
l’importance d’une direction locale solide, les capacités des individus et organisations locaux en matière de
législation, d’organisation et de lobbying sont capitales pour la bonne consolidation de l’envir onnement pour
l’activité civique. Le développement des capacités peut inclure la formation et l’amélioration des c ompétences
dans divers domaine, mais il peut aussi prendre la forme d’une facilitation de liens Sud -Sud.
4) Faciliter le dialogue
Les organisat ions internationales peuvent faciliter le dialogue en réunissant les OSC, les autorités
gouvernementales et les parlementaires dans des conférences, séminaires ou voyages d’étude. Le rôle
d’initiation peut s’avérer nécessaire à toutes les étapes de la réfo rme juridique . Cela n’implique pas pour
autant que tous les acteurs internationaux ont la même capacité de l’exercer. Les organisations mult ilatérales
comme l’ONU et les entités régionales sont particulièrement bien adaptées pour le faire. En effet, l a
par ticipation et la présence des organisations internationales peuvent accroître l’impact des efforts d e
plaidoyer fournis par les acteurs locaux. En outre, il est plus probable que les autorités gouvernem entales et
les parlementaires acceptent de participer à des réunions ou des manifestations, sur l’invitation d’acteurs
internationaux.
60 See the Universal Periodic Review Mechanism (June 29, 2006).
Interventions pour développer les capacités
Le dialogue et la discussion. Les OSC doivent pouvoir participer en personne à d es r éunions et discussions
avec les autorités gouvernementales et les parlementaires .
La sensibilisation. En abordant un probl ème, la première étape est de le porter à l’attention du public. Que
ce soit fait av ec des campagnes d’éducation grand publi c, ou via des campagnes « connaître ses droits »
plus ciblées, les OSC ont un rôle clé à jouer dans ce domaine.
L’utilisation des médias. L’usage efficace de tou s les média s ( journaux, radio, t télévision), et l’internet pour
dénoncer les violations, inf ormer le public, surmonter l’ isol ement , toucher les victimes et les bénéficiaires et
mobiliser les communautés est essentiel pour sensibiliser et plaider sa cause .
L’usage des technologies . La technologie internet peut être un instrument puissant pour la c ollecte,
l’organisation, la sauvegarde et la diffusion d’ information.
Capacité de plaidoyer . La comp étence de plaider une cause peut renforcer la réforme législative dans
n’importe quel context e. Il existe de nombreuses publications sur les outils, les te chniques et les straté gies
disponibles pour ceux qui pratiquent le plaidoyer, et les acteurs internationaux , y compris l’ONU , peuvent
aider à renforcer les capacités de plaidoyer, qui sont indispensables aux sociétés civiles dynamique s.
La capacité légal e. Très souvent, les OSC ont besoin d’être formées sur le cadre légal existant et sa mise en
œuvre, pour les aider à naviguer entre les nombreuses complexités et contradictions des lois et règlements
gouvernant leur activité . D’ailleurs, les avocats in dividuels devraient pouvoir utiliser des procédures
domestiques de litige – ainsi que des mécanismes internationaux relatives aux droits de l’homme – pour
défendre les OSC menacées.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 56
5) La diplomatie internationale
Dans beaucoup de situations, la diplomatie internationale peut être fondamentale à la défense de la société
civile. Cet outil stratégique est clairement une exception à la règle de la responsabilité locale. Les actions
diplomatiques internationales sont menées, à juste titre, par des gouvernements et des organisations
multilatérales. Cela dit, elles sont entreprises pour soutenir des acteurs loc aux et, très souvent, elles
complètent d’autres stratégies localement dirigées, telles que la sensibilisation et le lobbying. Co mme nous
l’avons mentionné ci -dessus, l’action diplomatique multilatérale a porté ses fruits en faisant avancer les
réformes jur idique s sur les ONG en Afghanistan (la Mission d’assistance de l’ONU en Afghanistan), en Albanie
(la Banque Mondiale), au Kazakhstan (l’OSCE) et en Russie (le G8). L’action diplomatique bilatérale peut
également être utile, en fonction de la relation entre les deux (ou plus) pays impliqués. Il est évident que les
acteurs internationaux doivent jouer un rôle principal dans cette connexion et rester attentif aux o ccasions de
faire des interventions diplomatiques fructueuses. En même temps, ils doivent être c onscients de leur propre
crédibilité en tant qu’acteurs externes et ne pas prendre le risque d’affaiblir l’action diplomatiqu e quand cette
crédibilité est insuffisante.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 57
V. Liste de contrôle pour la conception de programmes
Application de la réforme juridique
1) Faire une évaluation
a. Réaliser des analyses contextuelles : examiner l’environnement politique et social de façon globale,
afin d’identifier le pour et le contre; regarder aussi les expressions culturelles de l’organisation
communautaire et commen t l’engagement civique est perçu par différents secteurs de la population ;
b. Établir une carte des partenaires : identifier les partenaires ayant un intérêt direct dans la promo tion
ou l’obstruction de la réforme des lois ; identifier les partenaires ayant des obligations et qui doivent
en répondre (porteurs de devoirs) ;
c. Réaliser un bilan complet et professionnel du cadre juridique et règlementaire existant ayant un
impact sur la société civile, y compris la ratification de traités et conventions internatio naux qui
reconnaissent la liberté d’expression et d’association (parmi d’autres) ;
d. Faire de la publicité pour les résultats de l’évaluation juridique, en les distribuant aux partenair es pour
des commentaires et appréciations.
2) Attirer l’attention sur les q uestions juridiques concernant les OSC
a. Impliquer les partenaires dans la phase d’évaluation, en soulignant la reconnaissance juridique des
droits ;
b. Attirer l’attention sur le besoin constant de réforme au moyen, par exemple, de réunions trans –
sectoriels et d’ateliers locaux, en participant à des événements internationaux et en partageant des
pratiques internationales ;
c. Rester conscient des risques associés à la compensation des législateurs locaux.
3) Soutenir des groupes de rédaction inclusifs et tran s-se ctoriels
a. Soutenir un processus s’appuyant, dès le début, sur un groupe de rédaction inclusif et tran s-sectoriel ;
b. Agir en tant qu’initiateur, en réunissant les partenaires et en offrant un espace pour l’échange
d’information ;
c. Permettre et favoriser une direction locale du groupe de rédaction.
4) Promouvoir la participation du grand public
a. Diffuser les projets de loi/règlement à toute la communauté d’OSC via des moyens convenables, y
compris par courrier électronique, par Internet , dans les journaux, etc. ;
b. Solliciter des réactions et des commentaires sur les projets de loi/règlement ;
c. Mettre en place des mécanismes clairs par lesquels les réactions peuvent donner lieu à des
modifications significatives des projets de loi/règlement ;
d. Faire de la publicité pour les résultats de la phase de réactions/commentaires ;
e. Considérer les bénéfices de manifestations permettant le débat public, telles que des réunions
d’experts, des réunions dans les mairies, des conférences et des ateliers nationaux, etc.
5) Consolid er la réforme grâce à des liens transfrontaliers
a. Tenir compte des bénéfices de réunions, conférences et manifestations régionales ou internationales,
pour renforcer l’expertise locale ;
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 58
b. Tenir compte de l’appel ou de l’intervention des organismes régiona ux des droits de l’homme et/ou
des organisations intergouvernementales.
6) Soutenir la réforme avec une expertise technique
a. Offrir ou faciliter l’obtention d’une expertise internationale indépendante, professionnelle et
comparative, sur des questions local es ;
b. Aider les partenaires locaux à comprendre les approches règlementaires alternatives qui sont
disponibles, les avantages et désavantages de chacune d’elles et les conséquences de diverses option s
juridiques ;
c. Travailler afin de soutenir et non pas sup planter les partenaires locaux.
Suite à la réforme juridique
1) Aider à l’application de la loi
a. Former les régulateurs gouvernementaux sur les nouveaux cadres juridiques ;
b. Aider dans la préparation des règlements de la mise en œuvre et dans le développe ment de
formulaires et documents modèles destinés aux régulateurs gouvernementaux ;
c. Éduquer les représentants des OSC sur leurs droits et devoirs dans le nouveau cadre juridique ;
d. Préparer des documents éducatifs sur le nouveau cadre juridique au bénéfic e des représentants du
gouvernement et des OSC.
e. Rester alerte et réactif aux problèmes de mise en vigueur s’ils surviennent.
2) Surveiller et évaluer les nouveaux cadres juridiques
a. Prendre en considération le rôle des organismes « chiens de garde » et la m anière de les rendre plus
efficaces.
b. Développer et mettre en œuvre des outils de suivi, spécifiques au contexte.
Au -delà de la réforme juridique : défendre les OSC dans des circonstances difficiles
1) Définir une stratégie protectrice réaliste
a. Évaluer l’en vironnement général, les défis particuliers auxquels font face les OSC et des stratégies
réalistes en réponse ;
b. Penser aux perspectives à long terme en sélectionnant la stratégie appropriée.
2) Mettre en œuvre une stratégie protectrice
a. Surveiller les aspects réussis ou problématique de la stratégie et rester prêt à l’adapter si nécessaire.
b. Profiter des occasions pour consolider le travail, grâce à :
La mise en place d’alliances et de réseaux de soutien ;
La sensibilisation, localement ou internationalement;
Le renforcement des capacités des OSC locales ;
La facilitation du dialogue entre les OSC et le gouvernement, ou avec d’autres partenaires ;
L’utilisation de la diplomatie internationale.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 59
Annexe A : Foire aux Questions (FAQ)
Qu’est -ce que la société c ivile ?
Il existe une multitude de définitions du terme « société civile », et sa signification, toute comme sa portée,
font actuellement l’objet de débats et de discussions. Dans sa politique d’engagement avec les OSC ( 2001),
Le PNUD définit les organisa tions de la société civile et situe sa propre collaboration de la façon suivante : « les
OSC sont des acteurs non étatiques, à but non lucratif et sans ambition politique. Le PNUD collabore avec des
OSC dont les objectifs, les valeurs et la philosophie de développement correspondent aux siens. » D’autres
définitions se trouvent sur les sites web indiqués dans l’Annexe B.
Dans quelle mesure les OSC sont -elles concernées par le droit international ?
Le droit international concerne la société civile et l es OSC dans la mesure où les libertés et droits
fondamentaux sont ancrés dans certains instruments juridiques, y compris les libertés d’association, de
rassemblement et d’expression – sources desquelles coule la société civile et bases fondamentales de
pro tection des OSC. La liberté d’association donne aux individus le droit de créer des associations, de s partis
politiques, des syndicats et d’autres groupes composés de membres, pour défendre des intérêts collec tifs. La
signification et la portée de ce droit continuent de se développer et de s’affiner dans les accords et résolutions
de l’ONU, comme dans l’interprétation des tribunaux et des commissions opérant sous l’égide des trai tés de
l’ONU ou de dispositifs régionaux pour les droits de l’homme.
Les OSC ont -elles des droits au regard du droit international ?
Oui. Si les conventions et traités internationaux garantissant la liberté d’association et d’express ion
s’appliquent surtout aux individus, certaines garanties s’étendent également aux entités collect ives.
Les OSC sont -elles, en règle générale, gouvernées par une seule loi ?
Non. Les OSC sont gouvernées par tout un éventail de lois et de règlements, touchant, parmi d’autres, aux
questions de déclaration et de fiscalité, d’activité économique et d e financement public, de volontariat et de
philanthropie. Dans certains pays, il peut exister une seule loi, qui couvre des nombreux aspects du « cycle de
vie » d’une OSC, mais il y aura toujours d’autres aspects, tels la TVA, les contrats sociaux ou la pa rticipation à
l’élaboration de politiques, qui sont traités dans d’autres chapitres de la législation.
Existe -t-il une loi « modèle » ?
Non. La conception et la rédaction des lois ayant un impact sur la société civile sont des processus propres aux
be soins et à la culture du pays en question. Il n’y a pas de taille unique – le PNUD doit travailler avec ses
partenaires locaux pour concevoir les lois les plus adéquates et bénéfiques pour tous. Cependant, l’ ICNL
détient une myriade de matériels et de man uels, qui sont disponibles dans sa bibliothèque en ligne, et qui
donnent les bases et les principes nécessaires au développement de lois et de règlements adaptés.
Que signifie « sans but lucratif » ?
« Sans but lucratif » est utilisée plutôt que « à but non lucratif » pour souligner qu’un critère définissant est en
effet l’intention de l’organisation de ne pas faire de profits pour le bénéfice privé. Il est possib le qu’une telle
organisation fasse des bénéfices de temps en temps, mais cela ne constitue pa s son objectif principal.
D’ailleurs, son objectif n’est pas non plus de distribuer une partie de ses profits pour le bénéfice prive. La
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 60
caractéristique qui distingue les organisations sans but lucratif de celles ayant des buts lucratifs , c’est que les
pr emières sont gouvernées par le principe de non -redistribution.
Les OSC peuvent -elles légalement participer à des activités politiques ?
La réponse dépend du cadre juridique et de la définition d’activité « politique ». Le plus souvent, les OSC
peuvent participer à des activités de politique publique, qui peuvent comprendre la recherche et la formatio n,
le lobbying, et la publication de politiques. En effet, selon les normes internationales en matière de liberté
d’expression, les OSC devraient, comme to ut individu, pouvoir s’exprimer librement sur toutes les questions
d’importance publique, y compris la législation existante ou proposée, les actions et politiques de l’état, et les
élus ou candidats pour des postes publiques. Dans beaucoup de cas cependan t, des restrictions empêchent
les OSC de participer à des activités électorales, telles que les campagnes ou la collecte de fonds pour des
partis politiques ou des candidats.
Existe -t-il des « bonnes pratiques » en matière de réglementation des OSC ?
Oui. En plus des normes définies par le droit international, nous pouvons aussi parler de « bonnes pratiques »
pour la règlementation de la société civile. Le droit international établit des limites assez généra les, en
explicitant, par exemple, que l’état d oit garantir aux individus le droit de créer une association. Mais
beaucoup, sinon la plupart des questions règlementaires ne sont pas couvertes par le droit internati onal. Dans
ces cas, il faut examiner les bonnes pratiques règlementaires. Prenons, par ex emple, la question de savoir si
les OSC devraient pouvoir participer directement à des activités économiques. Selon notre étude des
approches règlementaires dans plus de 100 pays, nous pouvons conclure qu’une OSC devrait pouvoir
participer directement à de s activités économiques, sous certaines conditions.
Pour une liste de contrôle basique des mesures à inclure dans la législation gouvernant les OSC et q ui sont
compatibles avec les principes internationaux généralement acceptés, consultez la check -list de s lois sur les
OSC de l’ICNL.
Quelle est la première étape de la promotion de la réforme juridique relative aux OSC ?
La première étape est de réaliser une évaluation. Une évaluation professionnelle doit comprendre :
1) Une analyse contextuelle – c’est -à-dire, qui va au -delà de la loi, pour examiner l’environnement plus
général ainsi que les opportunités et les obstacles à la réforme.
2) Une carte des partenaires – c’est -à-dire l’identification des partenaires ayant un intérêt direct dans la
promotion ou l ’obstruction de la réforme des lois.
3) Une étude complète et professionnelle du cadre législatif et règlementaire existant, ayant un impact
sur la société civile.
Qui devrait diriger la réforme des lois gouvernant la société civile ?
La réforme des lois gouvernant la société civile devrait être dirigée par des institutions et des individus locaux.
Le rôle des organisations internationales est de servir de catalyseur à tous les niveaux.
Qui d’autre devrait être impliqué dans le processus de réforme jur idique ?
Cela dépend de la nature du processus de réforme. Néanmoins, le processus aurait plus de chances de réussir
s’il est inclusif et participatif. Parmi les partenaires du processus, on devrait retrouver les repr ésentants des
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 61
OSC et du gouvernement, e t aussi, à titre d’exemple, des parlementaires, des représentants du monde de
l’entreprise ou des universitaires.
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 62
Annexe B : Ressources sur la Société civile
Association for Research on Nonprofit Organizations and Voluntary Action (ARNOVA):
https://www.arnova.org/
Center for Advancement of Philanthropy: https://www.capindia.org/introduction.htm
Centre on Philanthropy and Civil Society: www.philanthropy.org
Charity Commission for England and Wales
https://www.charity -commission.gov.uk/tcc/intprog.asp
CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation: www.civicus.org
Civil Society International: https://www.civilsoc.org/
Société Civile : l’Organisation des États Américains: www.civil -societ y.oas.org
CIVITAS: The Institute for the Study of Civil Society: www.civitas.org.uk
Freedom House: www.freedomhouse.org
Global Legal Information Network: www.glin.gov
Global Policy Forum: https://www.globalpolicy.org/ngos/index.htm
Banque Interaméricaine de Développement : la Société Civile:
https://www.iadb.org/resources/civilsociety/index.cfm?lang=fr
Inter Press Service News Agency, Civil Society the New Superpower:
https://ipsnews.net/new_focus/c_s ociety/index.asp
International Center for Not -for -Profit Law: www.icnl.org
Johns Hopkins University: www.jhu.edu/~ccss/
The Comparative Nonprofit Sector Project: https://www.jhu.edu/~cnp/
Legislation Online (OSCE region): www.legislationline.org
London School of Economics, Centre for Civil Society: www .lse.ac.uk/collections/CCS
Open Society Institute Guidelines for Laws Affecting Civic Organizations:
https://www.soros.org/resources/articles_publications/publ ications/lawguide_20040215
L’Organisation de Coopération et de Développement Économiques, Société Civile :
https://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_34495_1_1_1_1_1,00 .html
PRIA – An International Centre for Learning and Promotion of Participation and Democratic Governance:
https://www.pria.org
Public Interest Law Initiative: www.pili -law.org
Rig hts International: https://www.rightsinternational.org/
La Commission européenne et la société civile : https://ec.europa.eu/civil_society/index_fr .htm
Le Fonds monétaire international et la société civile : https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/civf.htm
L’Organisation des Nations unies et la société civile : https://www.un.org/fr/globalissues/
THE ROLE OF LEGAL REFORM IN SUPPORTING CIVIL SOCIETY
AN INTRODUCTORY PRIMER – ICNL & UNDP – AUGUST 200 9 – PAGE 63
La Banque mondiale et la société civile :
https://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/ACCUEILEXTN/EXTTOPICSFRENCH/EXTCSOFRENCH/0,,menu
PK:1154059~pagePK:220469~piPK:220475~theSitePK:1153825,00.html
Union of International Associations: Web Resources on Civil Society: https://www.uia.org/civilsoc/links.php